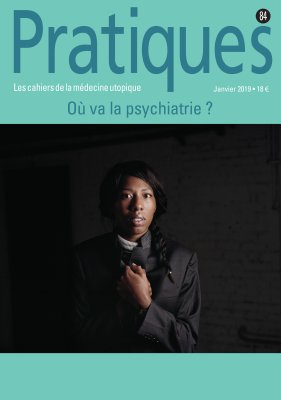Promenade dans les décombres de l’asile… [1]
Patrick Faugeras
Psychanalyste, traducteur, directeur de collections. Derniers ouvrages parus : avec Jean Oury, Préalables à toute clinique des psychoses, Érès, 2012. Traduction de Gaetano Bénédetti, Séminaires cliniques sur la schizophrénie, érès, 2014
Arpentant, une fois encore, les allées de l’hôpital déserté de Volterra, vieille bâtisse qui se dresse, depuis la fermeture des hôpitaux psychiatriques en Italie, comme une cathédrale éventrée au cœur de la Toscane, alors que toute trace de vie semble depuis longtemps effacée sinon réduite à quelques déchets épars, et tandis que mon pas déchiffre avec peine un chemin dissimulé sous les herbes sauvages, que seules des trajectoires obligées ont su naguère tracer, un sentiment d’étrange familiarité progressivement m’envahit.
D’abord, le frôlement des herbes et des ronces, comme cela se peut lorsque soudainement la nature suspend son souffle mais paraît lourde de possibles menaces, semble faire entendre, au-delà de ce désert de fin silence, le bruissement d’un monde aujourd’hui disparu.
Puis, par-delà les murs gris, au travers de fenêtres obscures, hachurées de barreaux, semblent s’afficher des ombres grimaçantes, le visage façonné par des années d’exil, lorsque la réclusion ne retient du visage que ses traits de misère.
Et puis la bouffissure d’une architecture qui semble cacher le vide, l’impuissance et la violence de convictions, qui furent un jour d’appoint, derrière la grandiloquence de ses arches, et l’épaisseur de ses murs. Plantés dans le sol, comme une idée que l’on impose d’autant plus fermement que le doute la taraude, les murs ne paraissent viser qu’à retenir et à étreindre, comme un poing fermé, quelque chose de terriblement élémentaire, l’homme qui penche.
Au lieu d’un monde, ou ce que l’on aurait voulu tel, un monde érigé toutefois à l’écart du monde, comme dans un repli de l’humaine nature, ils ont dressé des murs, élevé des grillages, tracé des frontières de pierres et d’interdits, non parce qu’ils furent uniquement contraints par un pressant souci de sécurité mais aussi parce qu’ils étaient poussés par l’insolence du concept.
Ils ont créé un monde à l’écart du monde, et quels qu’en soient les motifs, humanistes, sécuritaires ou pseudoscientifiques qui l’ont fondé et qui le fondent, sur lesquels il s’appuie ou se justifie, ils l’ont créé pensant étrangement que les murs d’enceinte ne feraient point obstacle à cette drôle d’idée, si paradoxale en soi, que l’on pourrait ainsi combiner enfermement et socialité.
Au-delà de ce sentiment d’abandon, un abandon qui serait bien plus ancien et bien plus essentiel que celui que l’on éprouve devant des lieux soudainement désaffectés, et cheminant aujourd’hui à travers la friche qui a repris ses droits, s’installe en soi la conviction qu’aucune existence n’a pu prendre fond de cet espace désolé. Pourtant les signes qu’un monde s’est, ici, essayé à naître parce que des hommes le voulaient, l’ont imaginé, conçu et imposé à ce bout de terre toscane, persistent encore de-ci de-là, évidés toutefois de toute signifiance. Une rumeur semble encore imprégner et sourdre des couloirs désormais déserts, jonchés de détritus, comme un écho à cet affairement désœuvré dont le rituel imperturbable ne servait qu’à scander le temps de l’éternité asilaire.
Ils ont imaginé un monde sans s’apercevoir cependant, et malgré toute leur sollicitude et leur grande ingéniosité, que ce monde qu’ils concevaient était déjà fini.
Mais comment fut-il possible que cet humanisme fin de siècle, qui fit et vit naître l’asile, confondît à ce point l’entre-soi et l’être-avec, comme si la violence de l’enfermement, la prétention des théories organicistes alors en cours, la brutalité des traitements qui s’en déduisaient, se devaient d’être adoucies par une conception, ou plutôt par l’idée d’une pseudo-socialité imposée par la force ?
Mais encore, alors que l’on peut encore discerner quelques traces des asiles-villages qui fleurissaient partout en Europe, comment fut-il possible que quelques démiurges aient cru un instant que l’on pouvait, de cette colonie peuplée d’êtres en déshérence, faire société par les seules vertus de la discipline et du travail ?
Ont-ils cru que l’être-avec-l’autre, ce que les Grecs appelaient le politique, pouvait se concevoir hors toute transcendance, c’est-à-dire se passer non seulement de l’idée banale qu’il n’y a pas d’un sans autre, comme une entame d’où l’être se déduit et s’appelle en présence ? Mais encore, ont-ils pu ne point reconnaître que toute relation, comme toute rencontre véritable, se fonde sur un sans limite d’où des bords pourront naître et se définir comme des points cardinaux à partir desquels l’être s’oriente et habite le monde ?
Auraient-ils, à ce point, confondu l’espace et le lieu, l’espace de l’affairement et le lieu de l’événement, l’espace au quadrillage convenu en fonction duquel les activités se distribuent, selon les heures du jour, le long des longs couloirs ou dans les champs voisins, ou lors de ces fêtes folles, maladroites caricatures de liesses villageoises, et le lieu, où justement quelque chose peut avoir lieu, un événement peut se produire, tout autant imprévisible qu’imprévu ? L’espace des activités et le lieu du faire, du moindre geste, de la moindre des choses, là où la répétition inlassable des mêmes gestes pourrait laisser la place à un infime écart, peut-être accueilli, recueilli comme la trace d’une subjectivité en exil ?
Auraient-ils à ce point confondu l’espace du dire, des idées et du discours, et le lieu de la parole, comme si un certain entêtement maintes fois soutenu tendait à recouvrir, par son insolente prétention à dire la vérité du réel, le faible murmure d’une parole, hésitante, errante, sans adresse aucune, que seule une écoute de la langue pourrait permettre d’entendre ? Comme un possible lieu de rencontre, là où, semble-t-il, une subjectivité défaite peut encore et seulement trouver à se tenir, tant bien que mal ? Le possible lieu d’une liaison, ténue, incertaine, peut-être éphémère mais détachée du lien auquel l’espace institutionnel oblige.
Et enfin, auraient-ils oublié que l’infime, le détail, ou ce qui s’avance nimbé d’ombre, dont les formes restent incertaines, mystérieuses parfois, est bien plus lumineux que la pleine lumière ? Car la pleine lumière est totale obscurité.
« Toute l’obscurité est dans le jour. Où tant bien que mal il faut s’orienter, tâtonner, balbutier ce qu’on a à dire. Mais l’infime est plus sûr que le reste. Un détail, une inadvertance. C’est ici le seul point de passage. » écrit Thierry Metz, poète et manœuvre maçon de son état, dans L’homme qui penche, son dernier opus avant de se suicider à 40 ans, et qui, ici, guide mes pas d’une façon plus assurée que ne saurait le faire toute doctrine.
Faute de paroles, de ces murs gris un bruissement semble encore sourdre, le bruissement d’humains affairés, affairés à ne rien faire, ou plutôt affairés à faire comme si, comme si les simulacres de socialité, plus ou moins savamment conçus et orchestrés, valaient signes de vie, comme si une docilité consentie à l’ordonnancement institutionnel valait signe d’une reconnaissance et d’une acceptation de la Loi qui régit les rapports humains, valait signe d’une possible guérison, ou du moins valait signe d’un retour ou peut-être d’une entrée dans le monde symbolique qui ordonnance les relations entre les hommes.
Ou alors, totalement défaits de toute velléité thérapeutique, le simulacre suffirait à laisser accroire à l’honnête homme que cet artifice construit de toute sapience, en toute conscience, outre la compassion humaniste qui semble s’en dégager, saurait combiner avec intelligence la réclusion, le travail et une certaine forme de communauté. Après tout, il n’est pas exclu de penser que certains de nos prédécesseurs, concevant l’asile village et pourquoi pas certaines formes de thérapies institutionnelles ou d’autres formes communautaires à l’anglaise, aient cru possible de créer de toutes pièces une forme de société qui, du fait de sa propre clôture, de son entre soi, s’est finalement avérée être une impasse.
Encordé mais pas lié, écrit Thierry Metz, laissant sonner ces quelques mots, sans adresse véritable, mais à travers lesquels résonne la désespérante entente d’une aliénation comme un type de lien sans possible liaison, une assignation sans ce tutoiement complice où les places s’échangent et se distribuent selon les aléas du désir que la parole porte et qui accorde mais n’encorde pas.
Pourtant « Un homme vous attend, “un morceau de parole cassée dans la main”. Il va vous dire ce qui chuchote en vous chaque fois que vous posez le pied par terre, chaque matin : rien ne va de soi » écrit Le Penven, à propos de L’homme qui penche.
Nul ne semble remarquer, ni mesurer, que ce soit au point du jour ou à ces heures d’une densité si lourde et si vague à la fois qu’elles restent indécises, l’effort qu’il lui faudra faire pour se hisser, puis se tenir sur ses deux pieds.
Lorsque j’étais enfant mes parents m’avaient offert une figurine en bois représentant Pinocchio, animée d’un mécanisme qui, lorsqu’on faisait pression sous la base, s’effondrait comme démantibulée puis se redressait tout soudainement à la moindre détente.
Pourtant, ici, se dresser ne dépend pas du jeu des articulations plus ou moins flaccides d’un corps qu’une détente relèverait de sa prostration mais invoque autrement une pénible construction, segment après segment, non pas d’un corps aux jointures bien marquées, mais plutôt, au risque d’un précaire équilibre, l’incertain et pénible assemblage d’un être-corps.
Chaque jour, se lever nécessite pour certains cet effort grandiose de se construire et de construire le monde qui va avec, tout ensemble ; non pas un monde qui serait libre de jouer avec les éclats du jour mais un monde soudé aux segments de son être-corps. Son être-corps est son être-monde.
Puis marcher ainsi, tenu serré aux multiples dehors d’un espace et d’un temps sans présence et sans bords, concevables seulement à travers les extravagances du délire. Marcher malgré tout d’un pas semblable, ou plutôt identique au pas de l’homme pressé qu’une prochaine affaire aspire vers son lointain. Marcher comme le rythme du monde l’imagine, lesté pourtant de pans entiers d’étants, figés, inactifs, intemporels, sans histoire, sans devenir.
Pourtant nul ne relèvera, ne soulignera cet héroïsme ordinaire et quotidien qui le fait se dresser face à la vulnérabilité qui le hante, cet effort quotidien accompli pour, dans l’affublement du monde et malgré le vide qui le guette, être comme tout le monde, un être-banal.
Je n’ose croire, parce que la clinique m’a appris que l’homme, ou le sujet si l’on préfère, se tenait en équilibre, plus ou moins assuré, sur un monceau de contradictions, que le grand enfermement auxquels les fous furent contraints ne se justifiât que de mesures de rétorsion et qu’il n’y eût point, en son principe, quelques considérations et visées, outre qu’idéologiques et sociales, théoriques et thérapeutiques. Je n’ose croire que le seul sadisme, bien que l’on ne puisse en nier l’occurrence sublimée au cœur même du désir de guérir, fut et soit le seul moteur et motif de pratiques dont la description des dispositifs fait quelquefois frémir mais plutôt, qu’au-delà ou en deçà, ces pratiques se soutiennent, et se soutinrent, d’une pensée du politique et de conceptions théoriques face à cette énigme de l’être à laquelle la déliaison psychotique nous expose.
- … d’une vieille (?) psychiatrie à la psychiatrie d’aujourd’hui…
Il ne suffit pas de penser, ou de croire, qu’une certaine dérive de la psychiatrie, voire son naufrage, dont on perçoit déjà l’annonce à travers l’exercice d’un langage qui, évoquant les sacro-saintes tables de la communication, ignore par là même que la véritable demeure de l’homme, c’est la langue, et le frémissement infini de ses déclinaisons, son bruissement, il ne suffit, donc, pas de croire que cette dérive pourrait être due essentiellement à des mesures économiques toujours plus limitées, sinon à des réglementations administratives toujours plus contraignantes ou à des impératifs idéologiques toujours plus affirmés ? Non pas, ce que la bouffissure de ces monuments architecturaux nous laisse entendre, au-delà de la solennité ou la fausse pudeur derrière laquelle ils se cachent, c’est qu’ils ont été conçus, imaginés selon les principes d’une science de l’homme et de la folie, une idée du progrès et du soin et une certaine idée de la vie sociale, de l’être ensemble.
En Italie, cet état des lieux fut tout de même favorisé par la longue domination idéologique des thèses organo-positivistes de Cesare Lombroso corrélant les troubles mentaux à des lésions ou à des phénomènes anatomopathologiques, ce qui servît à justifier un net désintérêt pour la vie singulière et collective des malades internés.
Mais s’il nous est plus aisé aujourd’hui de percevoir quelles croyances, quelles chimères, illusions ou superstitions ont présidé à l’édification de ces Monuments de raison, lorsqu’il s’est agi de construire des Lieux de folie, force est de constater qu’il nous est bien plus difficile de repérer « les espérances chimériques qui, à ce jour, nous font négliger la réalité » (D’Holbach), ou dit plus prosaïquement nous font négliger certains paramètres fondamentaux que la clinique a su patiemment échafauder.
Il nous plaît d’imaginer que le côtoiement de la souffrance de l’autre pourrait être l’occasion d’un dépaysement tel qu’il ne nous serait plus possible, le jour suivant, instruits d’un certain art de la rencontre, et parce que nous aurions été appelés à voir d’ailleurs ce qui au quotidien nous occupe, de voir et de dire les choses autrement, non pas telles que nous les concevons mais telles qu’elles nous apparaissent, ou plus exactement telles qu’apparaissant, nous les concevons.
Mais n’est-ce pas faire preuve d’une certaine légèreté, n’est-ce pas un luxe, alors que la psychiatrie n’en finit pas de se perdre à elle-même, que d’inviter à tourner résolument le dos au positivisme forcené ambiant ? Si la plus grande lumière peut être source de la plus grande obscurité, l’ombre, alors, loin d’être à tout prix ce qu’il faudrait chasser, plus que la trace d’une présence, pourrait donner consistance et profondeur à ce qui est. Et puis serait-ce un luxe, ne serait-ce pas pour autant un luxe nécessaire et essentiel lorsque, justement, on constate que le plein en face, où s’opposent les idées, n’ouvre aucune issue ? Bien plus, l’obliquité, l’art du détour, ne serait-elle pas, dans ce cas-là, l’approche la plus assurée, lorsqu’il s’agit de percevoir ce à quoi, à la fois, nous consentons mais aussi ce qui nous soumet et nous étrangle ? Autrement dit, lorsqu’il s’agit « d’ouvrir une possibilité de pensée », il faut pouvoir parler en étant délié de l’obligation de dire, et pour cela entrer dans l’épaisseur de la langue.
Tenir parole et non pas discourir, parler et non pas dire, étant convaincus, pour notre propre compte, que la clinique fondamentale, du moins celle qui importe, s’inaugure et se déploie d’une parole tenue, c’est-à-dire d’une parole délivrée de toute obligation de dire.
Tenir parole alors que le discours, drapé dans les atours de la rationalité, de l’efficacité, de l’avoir à rendre compte, invoquant sans cesse la vérité et le pragmatisme qui le fonderaient, nous presse de toute part et veut nous obliger à dire. Pourtant, lorsque la parole arrive à se faufiler à travers nos attentes et nos représentations, et arrive, malgré tout, à se faire entendre, il me semble que la responsabilité du clinicien est d’abord de faire en sorte qu’elle soit tenue, comme on peut le dire d’une note que la voix peine à quitter.
Quotidiennement les idées, les protocoles, les injonctions, les contraintes de tout poil manigancent pour faire taire cette parole « de fin silence », la forçant au sens, sans que l’on ne se rende plus compte qu’un sujet s’y trouve appendu. Est-ce si irréaliste que cela, que de penser que notre travail de clinicien consiste avant tout à faire en sorte que cette parole soit tenue, que nous accueillions et protégions sa venue et que nous œuvrions à ce qu’aucun discours ne la fasse taire, qu’aucune logique institutionnelle ne vienne la recouvrir, y compris lorsque c’est le patient lui-même qui s’en détourne ?
La langue est la terre que nous habitons. Et pourtant au-delà du malentendu inhérent au fait même de parler, cette habitation est souvent dévastée, non pas seulement parce qu’elle abrite le mensonge et la lâcheté, un propos qui pourrait n’engager à rien, pas plus celui qui l’énonce que celui qui l’écoute, comme une monnaie de singe ou de signes, usés jusqu’à la corde, qui ne serviraient qu’à assurer une reconnaissance, asseoir une appartenance, mais aussi parce qu’elle est désavouée dans sa dimension signifiante, dépouillée de son pouvoir de nous faire signe.
Des gens. Quelqu’un. Soi. C’étaient ces mots qui revenaient dans la bouche de Céline, la jeune infirmière, des questions sans cesse interrompues par la sonnerie du téléphone. Alors j’ai préféré ne rien dire. Demeurer introuvable.
J’ai parlé au psychiatre mais on ne s’est rien dit qu’on ne savait déjà. De souffrant, de tourmenté. Sans ailleurs. L’homme qui penche
- … ou de l’enfermement du sujet à la stérilisation de la langue.
Peut-être que la violence la plus grande exercée aujourd’hui, bien au-delà du champ spécifique de la psychiatrie où pourtant elle engendre de terribles conséquences, est celle qui vise la langue, qui œuvre à son délitement, et à l’effondrement de ce qui nous porte. Il n’y a pas qu’une seule façon de priver la parole de sa signifiance, en ne la rapportant pas à la langue dont elle s’excipe et à la vérité du sujet qui s’y trouve engagé, on peut, par exemple, comme cela se pratique dans divers instituts de formation et sur quoi certaines pseudos-thérapies se fondent, promouvoir une conception du langage où celui-ci serait ravalé à un pur système signalétique.
Comme jadis C. Castoriadis le remarquait, nous assistons à une « montée de l’insignifiance » où, à la fois, tout acte, y compris le plus violent, le plus méprisable se trouve banalisé et où penser s’avère aujourd’hui un exercice toujours plus difficile. On peut entendre cette « montée de l’insignifiance » à la fois comme une exaltation du rien, du sans importance, du fait divers qui se trouve ainsi élevé au statut d’événement mais aussi, à l’inverse, comme la banalisation de ce qui, outre l’indignation, devrait plutôt soulever notre colère. Il en va comme si tous les systèmes, les systèmes symboliques, les systèmes de valeurs et de référence, ces systèmes théoriques à partir desquels la réalité s’envisage, s’évalue, s’analyse, se pense, se trouvaient toujours plus relativisés. Plusieurs voix philosophiquement autorisées ne cessent d’attirer notre attention sur les avatars de l’individu contemporain qui, non seulement se trouve exposé à cette relativité généralisée mais aussi qui, de ce fait, se trouve exposé frontalement à une kyrielle de dispositifs sans plus avoir la possibilité de les penser, c’est-à-dire de penser leur cohérence et surtout leur articulation. Penser, c’est penser les articulations entre des informations, des évènements, des conceptions qui se présentent comme dispersés, non pour les ordonner dans une totalité, les unifier sous un grand tout, un grand Autre quelconque, mais pour, affinant ce qui les différencie, concevoir ce qui les apparente.
En l’absence d’une vision d’ensemble, le sujet contemporain semble se trouver face à une poussière, une atomisation, une multitude de branchements, d’éléments, de réseaux dont la cohérence et les logiques sont toujours plus difficiles à penser, sans possibilité aucune de les articuler, de les problématiser, faute de cette lame conceptuelle qui sépare, distingue, différencie ce qui se voudrait ou se présente comme semblable, homogène, équivalent. Certaines politiques récentes nous ont montré combien en l’absence d’une vision relative et distanciée des choses non seulement il était de mise de répondre au coup par coup, en émettant par exemple une loi au plus vif de l’événement, mais aussi d’amalgamer, sous l’effet d’une myopie et d’une grande ignorance, ce qui ne devrait pas l’être (schizophrènie et dangerosité par exemple). Dans le champ de la psychiatrie, comme il en va de ces lois qu’aucun système symbolique ne semble plus soutenir et qui collent aux faits divers tels qu’on les échafaude et monte en épingle, les pratiques les plus hétéroclites très souvent coexistent, sans la moindre dispute, répondant aux bizarreries des comportements de ceux dont nous avons la charge, dans l’immédiateté de l’événement, avec des réponses toutes faites, « protocolarisées », selon des guides de conduite, des « comment savoir se comporter vis-à-vis de… » où toute subjectivité s’absente sous des catégories préconstituées, ou pire avec des réponses que seule la raison raisonnante, le sens commun et raisonnable, dicterait. Plus de désarroi mais de l’impudence, puisque la technique, dans sa prétention manifeste, vient conforter l’individu contemporain dans l’attente et la croyance qu’il n’est plus besoin de penser parce que nous entrerions, si je peux me permettre cette approximation, dans ce que les linguistes appellent « le performatif », disons dans la pure effectuation, sans écart, sans médiation entre dire et faire.
Il est habituel lorsque l’on traite du Pouvoir, d’abord de s’intéresser au pouvoir de l’autre ou des autres et de le traiter comme une entité abstraite et générale dont on serait dépossédés ou a priori exclus. Et il est vrai que la culture de la hiérarchie encourage les vocations de petits chefs dont on sait que leur consentement à la soumission et à l’asservissement va de pair avec la jouissance éprouvée à commander le subalterne. C’est ainsi que Monsieur Toulemonde, bien à sa place dans l’échelle des mérites, jouit, quelquefois péniblement il est vrai et avec parcimonie, mais jouit quand même, à sa mesure, du simple pouvoir de pouvoir ce que l’autre ne peut pas. Et l’on peut se demander si les patients n’occupent pas très souvent le bas de cette échelle, essuyant bien involontairement rancœur accumulée, haine et sadisme que tout système de dépendance ne peut que susciter. La hiérarchie comme le squelette sur lequel toute institution se dresse, au double sens du terme, ou comme l’hydre de Lerne qui, dès qu’une tête est coupée en laisse surgir une autre – Tosquelles disait que les têtes sont faites pour être coupées – se régénère, se fortifie voire se renforce, auto-justifiant en permanence sa propre nécessité. Il est tout aussi vrai que les maîtres mots de l’idéologie libérale qu’un économisme qui se veut d’évidence impose à tout un chacun, la rentabilité, l’efficacité, la rationalité viennent à point nommé justifier et renforcer des partages qui, devenus autant de territoires, seront à défendre tout comme seront à défendre les frontières artificielles qui les délimitent. L’administration, dont la puissance ne cesse de se renforcer depuis que l’on imagine l’hôpital comme une entreprise, joue bien souvent sa propre partie, de façon quasi obsessionnelle, c’est-à-dire se perdant et nous perdant en rituels toujours plus complexes et sophistiqués où finalement l’objet central qui nous occupe, le soin, s’évanouit à l’horizon. Mais n’est-ce que le soin qui ainsi s’évapore sous les braises que le souffle gestionnaire attise, n’est-ce point aussi et surtout une part élémentaire de notre humanité, ou plutôt une conception fondamentale de l’être ensemble, l’être-avec-l’autre, une dimension sans laquelle nous ne sommes pas, qui se défait et se disloque ?
« Être humain c’est mutuel », écrit un poète, mais que penser alors de la première question surgie, lorsqu’un patient s’est suicidé dans un service, « Les mesures de sécurité ont-elles été respectées ? » Que penser de ce réflexe défensif qui, bien au-delà de la préservation de minces privilèges qu’une culture de la faute menace toujours d’entamer, semble oublieux de ce « souci de l’autre » qui, loin d’abord d’être altruiste, est ce qui nous fonde en notre humanité ? Mais où commence et où finit ce « souci de l’autre », suffit-il de s’en arrêter à l’événement, le suicide, ne faut-il point comme disent les philosophes l’envisager comme un phénomène qui détermine un monde dans lequel nous sommes pris et qu’il faut alors envisager à la fois comme totalité et dans le détail, dans ses moindres occurrences et dans ses multiples interférences et interrelations ? Est-il si juste, par exemple, que les uns comme les autres admettent que l’administratif ne fasse pas partie du soin, entérinant de fait un partage que seule une répartition fonctionnarisée des tâches permet de comprendre, alors que nous savons très bien que toute décision administrative est une intervention directe dans le champ de la clinique, jusque dans la relation fine et intime que nous entretenons avec les patients. Il suffit pour se convaincre de cela, de penser simplement à la façon dont, parfois, les plans de formation se conçoivent, sacrifiant toute pensée, toute réflexion approfondie, toute conception élaborée à une stricte fonctionnalité, une immédiate opérativité, un apprentissage à une stricte observance des protocoles selon une représentation pauvrement positiviste et mécaniciste du soin en psychiatrie.
Dans de multiples occurrences, on éduque les jeunes générations à traiter la langue comme s’il s’agissait d’un ensemble de signaux, et non pas de signes, appelant comme les sémaphores à des réponses univoques, rouge je m’arrête, vert je passe. Les théories de la communication ont toujours rêvé d’un langage dont aucune subjectivité, aucun contexte ou aucune circonstance, aucune possible interprétation ne viendrait troubler le contenu informatif. Fonctionnement binaire dirait Oury, où l’absence de toute élaboration – tournée vers la psychose, l’institution ou le transfert – a, cliniquement et humainement, des conséquences désastreuses, et que certains d’entre nous éprouvons au quotidien.
La parole se tient entre langue et discours. Pour qu’une parole se tienne ou soit tenue, faut-il encore que nous œuvrions à détacher la parole du discours, les séparer, creuser un écart au cœur même du discours, afin, et avec les ressources de la langue, de confondre ce dernier, de l’épuiser ou d’excéder la signification dont il se recouvre et se protège. Tenir parole serait alors maintenir un écart incomblable entre la parole et le discours, ou ce qui revient au même entre la signifiance et ces croyances ou convictions ou évidences ou « ça va de soi » auxquels nous nous sentons attachés.
Mais tenir parole c’est aussi faire face à l’ouvert, c’est aussi se tenir face à cet infini du sens auquel la parole nous invite et nous contraint, et qui nous échappe, c’est se tenir face à ce qui nous engage bien au-delà de ce que nous pensons. Il m’arrive parfois de répondre à une personne que l’angoisse submerge : « Je suis là », et de m’interroger sur ce que je suis en train de dire, ne sachant pas vraiment ce que cette expression recouvre, quelle signification elle a pour l‘autre, et à quelle éternité elle m’expose. Pourtant, je sais qu’il m’arrivera encore de la prononcer, tout en ne sachant pas véritablement à quoi elle m’engage ni ce que l’autre en entend mais que, malgré cet insu, je m’emploierai à ne pas me dérober devant elle.
Est-ce cela l’éthique, me sentir responsable, devant l’autre comme devant moi-même, d’une parole que j’énonce ou que j’accueille et dans laquelle je me trouve pris, sans que je sache véritablement à quoi elle m’engage ni quelles en seront les conséquences, toujours insoupçonnées et insoupçonnables ?
L’énigme de la parole disait René Char « bourdonne d’essentiel ». Et si cet essentiel, pour une large part, nous échappe, nous exposant à un ailleurs imprévisible et imprévu, il est surprenant de s’apercevoir combien la parole tenue nous tient, singulièrement, les uns avec les autres, bien autrement que ce que le discours peut promettre.
Nos regards sont souvent tournés vers ces extrémités que sont la vie et la mort, et les passions qui les accompagnent, et nous avons pris l’habitude de les considérer comme des paradigmes essentiels pour comprendre les problématiques existentielles auxquelles nous sommes exposés, mais peut-être que cette façon de voir, parce que nous sommes tournés vers le Sens, nous empêche de prendre la mesure du moindre événement, et de sa possibilité. Je veux parler de ce sentiment qui nous effleure quelquefois et nous laisse entendre que ce qui a lieu, l’existant, ne prend sa pleine signification non pas tant du moment de son émergence ou de sa disparition mais parce que cela aurait très bien pu ne pas avoir lieu. L’opposé de ce qui est, de ce qui a lieu n’est pas la mort, qu’aussitôt on redoute, mais la non-existence. C’est sur ce fond de non-existence que tout événement ou toute Rencontre prend alors sa véritable dimension, à savoir qu’à la fois il s’excipe comme une possibilité parmi d’autres et en même temps, fait surgir le non avoir lieu comme l’ombre dont elle se détache et par rapport à laquelle elle se signifie. Cet avoir lieu touchant à l’existence des choses, j’aimerais ici, en quelque sorte, l’aborder sur son versant existentiel et supposer, mais peut-être est-ce absurde ou ridicule, qu’il n’y a pas d’engagement possible et véritable sans ce sentiment de contingence de toute chose, et de ce qu’il induit. Et j’aimerais ici poursuivre l’idée que l’engagement de quelques-uns dans le mouvement de psychothérapie institutionnelle – et qui a fait collectif – plus qu’à des conceptions partagées, théoriques ou politiques, fut la conséquence d’un certain rapport au Sens et au réel, que je dirai contingent.
C’est de cette façon, j’imagine, que les « inventeurs » de la psychothérapie institutionnelle ont dû procéder, marchant au-devant d’eux-mêmes sans savoir encore vers où leurs pas les menaient, peut-être simplement guidés par ce qu’ils ne voulaient pas, ou peut-être aussi, paradoxalement, guidés par un certain assentiment aux choses. Mais l’assentiment et le refus ne sont pas des mouvements opposés. L’assentiment aux choses suppose le refus de ce qui se présente comme déjà organisé, corseté par le sens, au point qu’il est nécessaire non seulement de refuser ce qui ainsi se donne sans se donner, mais aussi de défaire l’étreinte du sens, pour que les choses apparaissent dans leur propre mouvement. Il ne s’agit pas seulement d’un mouvement de la pensée ou d’un choix esthétique, il s’agit aussi d’un positionnement politique.
Semblablement à l’Italie mais de façon un peu plus précoce, au sortir de la guerre en fait, les créateurs du mouvement de psychothérapie institutionnelle se sont à la fois inscrits dans le refus de ce que la guerre venait de révéler, l’extermination, entre autres, des malades mentaux au nom d’une idéologie se réclamant du pragmatisme et de la biologie, mais aussi se sont tournés résolument vers une pensée de l’ouvert, de la rencontre, de la signifiance, du poétique. La génération de psychiatres qui émergea dans les années 30, en Allemagne et plus généralement en Europe, probablement déçue par les échecs à répétition des pratiques thérapeutiques alors en cours dans les asiles et probablement envieuse des progrès que réalisaient la biologie, la physiologie, l’histologie, aspirait de plus en plus à se rapprocher de la médecine générale.
Toutes ces dimensions, et je pourrai en énumérer bien d’autres, étaient bien présentes, mais je crois aujourd’hui que la base de cette philia dont la matière est à la fois de nature politique, poétique, philosophique, clinique, poiétique dirait Oury, reposait fondamentalement sur un certain type de rapport au monde, que j’essaie maladroitement de définir, entre refus et assentiment, comme un certain rapport contingent au Réel.
Plutôt qu’un recours à des références philosophiques, psychanalytiques, médicales, sociologiques, même si d’une certaine façon, elles ont pu à un moment ou à un autre, servir d’échafaudage théorique à la pratique qui était en train de se développer, on peut parler alors d’un positionnement existentiel consistant à maintenir ouvert ce qui ainsi, peut-être poussé par les évènements du monde, s’ouvrait. Et pour cela tout était bon, pourrait-on dire, afin que l’ouvert reste ouvert, à condition bien sûr que la pensée ne se transforme point en dogme, que ne s’instaure, par effet, une hiérarchie et que la clinique reste au poste de commandement.
Ce ne serait donc pas tant un sentiment de précarité et d’incertitude suscité par l’état de guerre et ses suites, notamment lorsque la survie est en question, ou l’équilibre du monde, qui suffirait à l’expliquer mais plutôt un refus des ou du système visant à recouvrir de sa chape, rétrospectivement ou par anticipation, l’événement dans son surgissement, et le monde que ce surgissement instaure, et auquel « soudain nous sommes [2] ». Un monde s’ouvre auquel je suis, d’une rencontre peut-être, et m’appelle à me tenir dans cet ouvert, veillant à ce qu’il ne se referme point sur lui-même ou qu’il ne s’abîme dans une répétition qui ne laisserait plus aucun reste.
C’est en cela que la pratique psychiatrique de Roger Gentis, comme celle de Tosquelles, d’Oury et de quelques autres, est politique d’essence – en écho lointain à ce que disait Basaglia : « Faire de la psychiatrie, c’est faire de la politique ». Elle est politique d’essence dans la mesure où elle va s’employer à rendre et à maintenir possible, contre la maltraitance asilaire, la surdité idéologique, le pouvoir des pouvoirs, les résistances de tous ordres, y compris celles du sujet, mais aussi la dictature du sens et des systèmes, une clinique des psychoses non seulement respectueuse de ce mode d’être au monde mais aussi soucieuse de l’être-avec.
Car, me semble-t-il, l’apport révolutionnaire du mouvement de psychothérapie institutionnelle, comme d’autres à cette époque-là, a été de mettre la clinique au poste de commandement, et la clinique la plus exigeante qui soit, celle des psychoses. Comment faire en sorte pour que ces existences œuvrées, bricolées, à l’équilibre incertain, improbable, ou bien complètement défaites, en morceaux, ne soient point méconnues, niées, rejetées, soumises à l’orthodoxie de la raison, voire quelquefois purement anéanties ? Comment aussi entendre ce que la psychose peut avoir à nous apprendre sur les conditions de l’existence, comment se rendre disponibles pour accepter que cette modalité particulière d’existence vienne en interroger les paramètres fondamentaux ? Mais encore comment faire en sorte que les résistances, quelles que soient les formes qu’elles adoptent, les phobies, quelles que soient les rationalisations qu’elles trouvent, n’empêchent un accueil accueillant, c’est-à-dire cet accueil qui s’oblige à se tourner vers sa propre possibilité d’accueil ? Comment nous acquitter de cette tâche que l’autre souffrant nous confie, faute de le pouvoir lui-même, de faire tenir ensemble, trouver une certaine cohérence, serait-elle quelque peu étrange, inouïe, insolite, serait-elle d’emprunt, afin que les éléments dispersés qui peut-être le persécutent, se trouvent pour un temps rassemblés ? Et encore, comment admettre l’idée que la clinique des psychoses ne se limite pas à l’espace clos d’une institution, d’un bureau ou d’une relation mais qu’elle a pour limites, les limites du monde ? Enfin comment accepter ce à quoi elle nous oblige, c’est-à-dire à chercher aux quatre coins du monde comme aux quatre coins de la pensée, les liaisons qui font défaut à un sujet en train de se perdre ?
Pourtant je sais qu’en deçà de cet affairement sans consistance, en deçà de la vanité de nos croyances, au-delà de ces simulacres de socialité qui souvent s’imposent avec violence ou séduction, se tient tapi un désarroi qu’aucune prouesse, aucune trouvaille, aucune technique ne pourra véritablement cacher, contenir, circonvenir. La pleine positivité des savoirs à la mode que chaque décade pousse en avant, comme si leur pseudo-nouveauté n’avait pour pendant qu’une ignorance savamment entretenue quant aux chemins de traverse et autres tentatives que d’aucuns ont empruntés ou essayés, cette aspiration à la pleine lumière tend, paradoxalement, à cacher ces moindres détails où un être se montre, presque par inadvertance, et que seul, me semble-t-il, un certain désarroi, pourrait laisser entrevoir.
« Encordé mais pas lié »
Pourtant je sais le désarroi qui nous étreint face à la déliaison psychotique, cette impuissance ressentie lorsqu’on échoue à trouver une voie pour rejoindre un sujet en exil, ces déceptions répétées alors que nos attentes les plus vives se trouvent encore une fois déçues, je sais nos incompréhensions mais surtout combien tout cela nous affecte bien au-delà de ce que nous pensons, en ce point sensible de l’être autour et à partir duquel notre subjectivité s’enroule et se déploie tout à la fois.
Gaetano Benedetti, grand clinicien injustement méconnu en France, a souvent montré combien, alors que la déliaison psychotique serait insupportable pour celui qui n’est pas dissocié et qui, face à cet inacceptable, serait tenté d’user de tous les recours, de tous les artifices à sa disposition, du plus persuasif au plus violent, du plus savant au plus rudimentaire pour faire rendre raison à celui qui ne le peut, G. Benedetti a montré que de ce désarroi peut naître la possibilité, un point de passage. Encore faut-il reconnaître que l’inconscient n’est pas qu’une machine vouée à reproduire les mêmes bévues, à replonger dans les mêmes impasses mais qu’au-delà ou en deçà de cette répétition que noue le symptôme, il est aussi condition d’un dépassement, condition de la sublimation, il est aussi un outil thérapeutique. Mais encore faut-il reconnaître que ce désarroi que nous éprouvons est déjà l’esquisse d’une réception en cours, que le transfert est à l’œuvre, et que si nos états d’âme ne sont plus tout à fait les nôtres, c’est que s’est ouvert ainsi, pour des êtres en manque de présence, la possibilité d’une relation.
« Encordé mais pas lié », écrit Thierry Metz, l’homme qui penche, au déclin de sa jeune vie de poète-manœuvre, alors qu’il assiste impuissant, en ce dernier lieu scénique qu’est l’hôpital psychiatrique de Cadillac en Gironde, au ballet d’êtres fantomatiques en quête d’un moi difficile à rejoindre, parce que leurs existences ne semblent pas plus attachées aux choses de la vie qu’aux relations ou à un quelconque pathos.
… On cherche un habitant qui n’est plus dans la maison. Pourtant n’est-ce pas lui que l’on aperçoit, à l’orée de ce qui est, ne sachant pas où il va, de dos, faisant un signe d’adieu ou de reconnaissance, un signe, c’est tout pour les jours passés, pour ceux à venir ? N’est-ce pas l’homme qui penche, vu de trop loin maintenant, ou trop tard ? Thierry Metz.