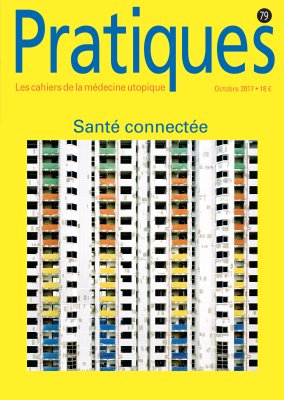Entretien avec Annie Catu-Pinault
Médecin généraliste
-
-
-
- Louis Velluet, généraliste et psychanalyste, a écrit pour Pratiques. Nous l’avions interviewé en octobre 2014 pour le n° 67 : « La folie. Une maladie ? ». Il nous a quittés le 30 mai dernier. Annie Catu-Pinault nous livre ici ce que le travail et les idées de Louis Velluet ont apporté à sa pratique.
-
-
Annie Catu-Pinault : Je suis « tombée dans le Balint » à la fac lors d’une grève, alors que j’étais encore externe. Un des médecins généralistes venus à notre rencontre pour discuter m’a parlé de Balint et cela m’a tout de suite intéressée. J’ai commencé à lire ses ouvrages et j’ai demandé une dérogation pour aller faire un stage chez un généraliste, ce qui n’existait pas à l’époque. J’ai soutenu ma thèse : « Psychothérapies de soutien avec le médecin remplaçant », parce que déjà en tant que remplaçante régulière, je voyais des gens avec qui, je ne sais pas comment, s’enclenchait « quelque chose ». Balint disait que derrière la plainte, il y a autre chose et qu’il faut essayer de comprendre quel est le vrai problème, chercher ce qui se « cache » derrière la souffrance au travers du symptôme. J’étais donc très préparée à rencontrer Louis. Mon compagnon m’a proposé un jour de venir à l’Atelier. J’y suis allée et n’en suis plus jamais partie.
L’Atelier français de médecine générale se tient deux fois par an. Les médecins sont invités à écrire une histoire clinique sur un thème donné par un appel à écriture. L’histoire est lue par l’auteur puis discuté en groupe. Tous les débats sont enregistrés. Plusieurs mois plus tard, la revue est éditée. Elle contient les textes lus, un résumé de chaque discussion et un exposé des éléments théoriques de l’histoire.
Qu’est-ce que Louis et le travail de recherche de l’Atelier m’ont apporté de plus que le Balint ? Il me semble que c’est cette idée de séminaire sur un thème précis avec une trace écrite et cette volonté didactique par rapport au reste de la profession. On travaillait non seulement pour nous, mais on essayait de transmettre ce qui s’y faisait. Louis avait un accueil particulier, une ouverture à chacun… j’aimais bien aussi qu’il soutienne les gens dans ce qu’ils essayaient de faire, sans jugement. Alors que dans le Balint, avec des psychanalystes non généralistes, il y avait une espèce de censure : « Ah non, mais là maintenant vous allez sur le domaine des psys ». Louis ne faisait pas du tout barrage, au contraire !
Louis coanimait l’atelier avec Anne-Marie Reynolds, sa compagne qui avait fondé l’Atelier avec lui. Elle aussi était psychanalyste et généraliste, ils écrivaient la revue ensemble. Quand Anne-Marie est décédée le 5 septembre 1997, il y a eu un blanc. Louis a quand même continué les séminaires, puis il m’a demandé de l’aider à rédiger la revue. Petit à petit, j’ai pris ma place dans l’écriture. Les participants écrivaient et leurs histoires cliniques permettaient une recherche commune et une conceptualisation sur un thème. Louis était très discret durant le séminaire au niveau conceptualisation, après, dans la revue, il écrivait les idées qu’il avait envie de faire passer de manière très accessible, il ne jargonnait pas, il avait un langage direct et compréhensible par tous. Au début, on ne faisait pas une retranscription intégrale des discussions. Mais comme je m’étais aperçue que parfois Louis et moi nous n’entendions pas la même chose, j’ai commencé à tout écrire in extenso selon la procédure conseillée dans les recherches qualitatives. Le mot à mot amène une certaine rigueur scientifique dans la démarche de recherche.
Je suis de cette génération formée à l’Evidence Based Medicine, l’EBM, la médecine fondée sur les preuves. Parallèlement à cette conviction de l’abord psychosomatique, j’ai adopté cette volonté de respecter les dernières données de la science. J’ai participé à des conférences de consensus, mais j’ai toujours essayé d’avoir ces deux aspects en même temps. Je suis aussi directrice de thèse et médecin enseignante à la fac. J’ai choisi de diriger des thèses qualitatives en opposition aux thèses quantitatives qui sont souvent des travaux statistiques chiffrés. Par exemple : combien de diabétiques on suit ? Combien ont une hémoglobine glyquée dans la norme ? etc. Les thèses qualitatives s’intéressent plus au processus et à la relation. Par exemple comment les diabétiques prennent leur traitement, ou pourquoi ils ne font pas leur régime, et là on discute avec les diabétiques et avec les médecins.
- Pratiques : N’y a-t-il pas une antinomie entre l’EBM et la psychanalyse ?
Non pas du tout ! La revue de l’Atelier que je suis en train de rédiger porte sur le thème des croyances. Un médecin raconte qu’il suit un patient qui a eu le crâne enfoncé en faisant du bateau. Ce médecin a un travail somatique lourd avec ce patient parce qu’il a un risque de phlébite, qu’il est constipé, plein de choses à surveiller. Parallèlement, elle est « titillée » par l’écoute de son épouse qui exprime toute la difficulté que pose cette vie-là, parce qu’il est en fauteuil roulant, ne peut pas parler, c’est très compliqué au quotidien. Le patient a des crises de violence à cause de tout ça, et le médecin se dit : « il faut que je trouve une façon de faire parler ce patient ». La discussion du groupe a porté sur comment elle pourrait faire. Un collègue lui dit : « Mais pourquoi tu ne consacres pas une de tes visites à ne faire que ça ? » Elle répond : « Je ne peux pas parce qu’à chaque fois, il y a plein de choses à vérifier. » On est donc bien dans cette coexistence du somatique et de ce que vit ce patient. Comment l’aider à aller mieux sur le plan psychologique ?
L’EBM, c’est effectivement les nouvelles données de la science, mais en s’adaptant au patient. L’EBM dit d’adapter les connaissances au patient singulier. Il faut que, dans notre tête, nous ayons les nouvelles données de la science, mais pour pouvoir les appliquer, il faut tenir compte du patient que nous avons devant nous.
J’ai participé un jour à la rédaction d’une question d’internat ; il s’agissait d’un patient diabétique atteint d’un cancer en phase terminale. L’un dit : il faut vérifier son HBA1C et son régime alimentaire. Il n’avait pas pensé qu’il était inutile de lui casser les pieds avec son régime diabétique !
- Pratiques : Les jeunes n’ont-ils pas tendance à utiliser l’EBM comme des guidelines, les l’appliquer à la lettre ?
Les nouveaux départements d’enseignement de la médecine générale essayent d’équilibrer les deux aspects. Louis a œuvré à cela en introduisant les groupes Balint auprès des étudiants il y a plus de vingt ans, à la faculté de Bobigny, pour former les étudiants à cet équilibre entre les données de la science et l’histoire propre du patient. Tous les médecins n’arrivent pas à faire cela parce que ça demande d’accepter de se questionner sur la vie, sur les valeurs… Certains sont trop déstabilisés par cette posture. On est quand même très peu à faire du Balint parmi les généralistes installés. On peut espérer que les plus jeunes, ayant pris cette habitude à la fac, auront moins peur. Louis prônait que les groupes Balint soient rendus obligatoires à la fac, même pour les futurs chirurgiens. Nous avons participé à une étude conduite par Philippe Jaury auprès de trois facs parisiennes sur l’empathie. Nous avons montré qu’il y avait une augmentation de l’empathie des étudiants de 2e cycle qui avaient participé à un groupe Balint. Grâce à cette étude, les groupes Balint sont obligatoires pour les externes à Paris 5. Ce n’est pas encore le cas dans toute la France, mais parmi les enseignants moteurs de l’écriture de la médecine générale, certains ont écrit sur les compétences que doivent acquérir les étudiants et l’empathie en fait partie. Beaucoup d’enseignants défendent la place de la relation. On réfléchit actuellement à écrire ce que peut être l’approche Balint dans les facs. Louis a d’ailleurs écrit un texte où tout est déjà là. Ce n’est pas tout à fait la même chose que le Balint avec des médecins installés qui vont y participer quelques années. Les étudiants vont avoir moins de séances et ne sont pas volontaires.
- Pratiques : Écrire ce qu’est la médecine générale, cela permet aux autres de s’en saisir.
L’effort soutenu d’écriture de Louis est fondamental. Il a écrit pour la revue, mais aussi pour les congrès de médecine générale et pour la revue de la Société Médicale Balint. Ses interventions donnaient souvent lieu à un article. Le fait d’être présent dans les congrès, de proposer un atelier Balint, de réaliser un diaporama, cela laissait une trace. Il m’avait fait lire des polys qu’il avait écrits pour la faculté de Bobigny il y a vingt ans et dans ces polys, il y avait cette histoire des trois espaces qui est extraordinaire.
Cette conceptualisation des trois types de relation que l’on peut avoir avec le patient est d’une limpidité totale. Il s’agit de la place que le médecin prend, accepte de prendre ou n’ose pas prendre pour essayer d’autonomiser le patient. Pour moi, ce concept me nourrissait et clarifiait ce que je faisais en consultation, ce qu’on faisait en groupe. Se poser la question : Où te places-tu avec ton patient ? Tu vois bien que tu es un peu bloqué dans le maternage ou le paternalisme et que tu n’es pas allé voir du côté de son histoire. Les étudiants, comprennent tout de suite. Je l’ai alors poussé à ce que l’on écrive un article dans la revue Exercer, la revue du Collège national des généralistes enseignants. Cet article en a enthousiasmé plus d’un et lui a donné l’élan pour écrire son livre : Le médecin un psy qui s’ignore. Un ouvrage clair et accessible, pas de l’intellectualisme. Il raconte et met en mots notre pratique quotidienne, pour qu’on la voie avec un recul conceptuel.
- Pratiques : Pouvez-vous développer ce concept des trois espaces ?
Le premier espace, c’est en quelque sorte le bébé avec la mère ou l’enfant avec les parents. Le patient se conduit comme s’il était un enfant. Quand on lui demande : « Que pensez-vous de votre traitement ? » Le patient dit : « Moi je ne sais pas, Docteur, c’est vous qui savez ». Il ne veut surtout pas prendre de responsabilité. Je pense à une de mes patientes diabétiques qui, au bout de vingt ans d’insuline, ne savait toujours pas comment s’en servir et en même temps n’arrêtait pas de se plaindre de sa belle-fille. Quand je lui disais : « Mais pourquoi vous ne vous adressez pas à votre fils ? » Elle n’entendait pas ce que je lui disais. Ce n’était pas pensable pour elle que ce soit son fils qui gère et en même temps ça lui faisait beaucoup de bien de se plaindre de sa belle-fille. Dans le premier espace, on écoute, on sait que le patient ne va pas forcément élaborer autour de sa maladie, mais que ça peut lui faire du bien quand même d’exprimer et de libérer un peu ses tensions. Si on en reste là, on ne va pas autonomiser le patient, il va rester dépendant toute sa vie et ce n’est pas forcément satisfaisant. Ce que disait Louis, c’est qu’il y a des médecins qui sont très contents d’être dans cet espace-là où ils sont des grands docteurs. Nombre de patients arrivent à supporter ce type de relation parce qu’ils pensent que c’est ce que le médecin attend, qu’ils racontent leurs symptômes, mais ils n’en sont pas forcément satisfaits. Si le médecin essaye de tendre des perches en disant : comment se fait-il que vous ayez une poussée de tension, qu’est-ce qui se passe en ce moment ? Certains patients vont alors dérouler tout ce qui ne va pas dans leur vie à ce moment-là et sont très contents de pouvoir s’exprimer : « Ah oui je n’avais pas pensé à ça » et du coup ils vont enchaîner comme ils pourraient enchaîner chez le psychanalyste sur les idées qui leur viennent à ce moment-là. Le premier espace, c’est aussi l’espace dans lequel les gens sont quand ils apprennent une nouvelle grave, là il y a une régression. Même si ces patients sont autonomes d’habitude, au moment où on leur annonce une catastrophe, ils vont arriver dans cet état de régression où ils ont surtout besoin d’être écoutés, maternés, soutenus au sens de Winnicott qui parle du soutien, du holding.
Dans le deuxième espace, le patient est d’accord pour qu’on commence à lui montrer des liens, mais il est un peu comme un ado avec ses parents. Il veut être autonome et il veut en même temps être aidé et, à certains moments, il n’est pas content de ne pas avoir assez d’autonomie. Un nouveau patient dit qu’il a mal à l’estomac. Je lui demande quel type de douleurs – c’est l’EBM – et j’en conclus qu’il a probablement un ulcère à l’estomac. Du coup, je m’interroge, pourquoi est-il dans cet état-là : « Vous avez des soucis en ce moment ? » Là le patient se braque un petit peu et me dit : « Mais pourquoi vous me demandez ça ? » « Vous savez les douleurs d’estomac, c’est souvent lié à du stress… » « Effectivement j’ai des soucis (ton un peu cassant) ». Je lui pose quelques questions puis : « Excusez-moi, je vais peut-être encore vous déranger, vous n’êtes pas obligé de me répondre, mais est-ce que vous pensez que vos soucis vont durer longtemps ? « Oui je pense » « Est-ce que vous avez déjà pensé à aller voir un psy pour en parler ? » « Non, mais je veux bien une adresse. » Je revois le patient quinze jours après, à qui j’avais donné un traitement (le physique) et une adresse (le psychique). Le patient me dit qu’il n’a pas pris de médicaments parce que je lui avais dit que c’était psy. « Je vous ai dit que c’était lié à vos soucis, mais je vous ai aussi donné un médicament parce que le corps, il faut aussi l’aider et le protéger. » « Bon d’accord, je vais le prendre ». Quelque temps après, ce patient, qui avait été voir le psy qui l’avait mis sous anxiolytiques et sous antidépresseurs en raison de ses idées suicidaires, revient me voir et me demande : « Est-ce que je peux prendre un peu plus de Lexomil® ? » « Vous pouvez prendre entre un quart et un comprimé en prenant par quart et en prenant le moins possible. » La consultation suivante, il me dit : « Quand même, vous avez pris un grand risque avec moi ! » « Ah bon ? » « Oui vous m’avez laissé faire n’importe quoi avec mes médicaments. » « Je ne vous ai pas laissé faire n’importe quoi, je vous ai donné une limite et j’ai eu l’impression que vous aviez besoin de maîtriser une partie de votre traitement ». Il sourit et il était content, il avait vérifié que je savais ce que j’étais en train de faire. Sous-entendu : je me rapproche, je me recule, je vérifie que tu sais faire, je vérifie que je suis bien protégé. Ce n’est plus l’enfant, c’est plus élaboré que ça. C’est comme ça que parfois, les patients ne font pas faire les examens qu’on leur prescrit parce que ce n’est peut-être pas si important que ça, parce qu’ils ont envie de voir notre réaction. Il y en a qui nous titillent avec Internet, il y en a qui font exprès, il y en a qui ne font pas exprès… ça, c’est le deuxième espace. Et on commence à s’intéresser à l’histoire familiale et aux problèmes de comportements inadaptés, de « répétition »…. Et le patient nous suit là-dedans.
Le troisième espace, c’est celui de la relation adulte-adulte, le patient sait très bien ce qu’il vient nous demander, il a un symptôme ou il n’en n’a pas, mais il vient en disant : « Là ça ne va pas, j’ai besoin de vous parler. » Vous me direz, pourquoi ils ne vont pas chez le psychanalyste ceux-là ? Ils vont aussi parfois chez le psychanalyste, mais là Balint explique bien pourquoi il y a des patients qui sont plus à l’aise avec le généraliste qu’avec le psychanalyste, parce que le psychanalyste est « un peu loin ». Louis a très bien répercuté ça, c’est l’histoire du défaut fondamental décrit par Balint. Des patients vont être plus à l’aise pour faire un travail de fond avec un généraliste. Ils ont besoin de le faire dans des conditions où ils se sentent plus en sécurité, avec éventuellement des allers-retours avec le corps. Avec des symptômes et pas de symptômes. C’est dans le troisième espace qu’on se retrouve à faire des psychothérapies en médecine générale.
Ce concept des trois espaces est pour moi tellement évident et clarifiant que j’ai eu envie de le transmettre aussi bien aux médecins avec qui on fait des séminaires qu’aux étudiants. Les uns comme les autres s’approprient ce concept : « Ah mais ton patient, là il est dans le premier espace, et là il est dans le deuxième espace. » Par rapport à cette idée d’EBM, c’est aussi très clarifiant. L’EBM, on est dans le premier espace, on fait le vétérinaire, si on ne prend pas la dimension adaptation au patient.
- Pratiques : Cette densité du soin et de la relation de soins est souvent gommée par les modes de gestion actuels.
Là-dessus, les médecins généralistes ne sont pas les plus mal lotis, parce que finalement on fait notre cuisine comme on l’entend. J’ai l’impression que je fais ce que je veux, mais ça me coûte cher, parce que j’ai des consultations d’une demi-heure… Cet aspect du soin prend du temps parce que c’est souvent une deuxième consultation qui commence, est-ce que j’ouvre la porte ou est-ce que je ne l’ouvre pas ? Je pense à un patient qui vient consulter pour un rhume, côté EBM en cinq minutes c’est réglé. Mais je pose la question : « Vous étiez fatigué ces temps-ci ? ». Parce que quelqu’un de 30 ans qui vient pour un rhume je ne trouve pas ça normal. Pour moi, c’est un signal. Comment se fait-il qu’il n’ait pas géré ça tout seul ? S’il n’a pas géré ça tout seul, c’est qu’il a besoin de se faire materner. Donc il est dans le premier espace. Et bien ce patient avait perdu son meilleur ami dans une crevasse quinze jours avant. « Ce n’est peut-être pas un hasard que vous soyez là aujourd’hui… » Ça, c’est le côté prise en compte psychosomatique que Louis m’a apporté et moi j’aime bien donner cet outil au patient : « Probablement vos défenses immunitaires ont baissé parce que vous avez eu ce choc émotionnel… » C’est un peu la même chose que celui qui a mal à l’estomac ou que celui qui fait une crise d’urticaire, à un moment le corps réagit. Louis avait des images très concrètes. Ainsi, il parlait du logiciel pervers. Le logiciel pervers, c’est l’histoire familiale du patient qui fait qu’il va être dans la répétition ou qu’il ne va pas savoir s’attacher ou ne pas avoir confiance dans les autres ou être autoritaire etc. Cette idée de logiciel pervers, je m’en sers et je la transmets au patient, ça les fait rire parce que des fois ils me disent : « Mais comment on change ? » « Maintenant que vous avez repéré que le logiciel a des problèmes, il faut que vous arriviez comme sur un ordinateur à vous dire : tient, là, je vais intervenir pour changer quelque chose. » Louis était très fort pour transmettre des idées psychanalytiques avec des images claires. Il parvenait à faire cette synthèse entre le monde dans lequel on vit et les concepts psychanalytiques. Il soutenait les collègues dans leurs capacités et leur envie d’aider les gens au-delà de la psychologie que la faculté nous a autorisés à faire avec les patients. En tant que psychanalyste et généraliste, il avait une place essentielle pour nous autoriser à aller plus loin, parce qu’il avait les deux casquettes.
- Pratiques : La psychosomatique est maintenant très décriée.
Louis disait : « On n’est pas asthmatique, on fait de l’asthme. Ça laisse la possibilité de ne plus en faire. » La psychosomatique, je l’ai intégrée à ma pratique. À l’Atelier, quand on travaillait sur des thèmes cliniques, la grossesse, les pathologies rhumatismales, les maladies auto-immunes, on travaillait sur ce lien. Après en consultation, ça nous aidait à voir les patients autrement. Par exemple, le diabète ne commence pas toujours à n’importe quel moment de la vie. Des chercheurs ont montré que quand on change le régime alimentaire des gens sur une courte période, mais très profondément en mettant beaucoup moins de calorie pendant quelque temps, le diabète peut disparaître. C’est quand même extraordinaire, le diabète peut être une maladie guérissable, alors qu’on a appris que c’était à vie ! Si on part du principe que ce n’est pas un hasard de manger des sucreries, de manger n’importe comment, que cela peut être la compensation d’autre chose, alors on a d’autres outils pour aider le patient à éventuellement aborder son régime autrement. L’évolution actuelle de la neurobiologie nous aide énormément. On a plein d’exemples de ce lien psychosomatique. C’était un des chevaux de bataille de Louis que de montrer le lien entre le fonctionnement du corps et le fonctionnement psychique.
La différence entre l’Atelier et le Balint, c’est que quand on sortait d’un séminaire de l’atelier, on n’avait pas « décoincé » un patient, on avait « décoincé » un certain type de pathologie et tout d’un coup, on avait d’autres ouvertures pour repérer des événements traumatiques comme l’inceste qui revenait très souvent dans nos histoires cliniques. L’idée de logiciel pervers, l’étude des familles dysfonctionnelles, nous faisaient porter un nouveau regard sur des pathologies qu’on regardait d’une façon très biomédicale auparavant.
Pour prolonger, je voulais dire aussi que cette volonté de transmettre qu’avait Louis était totalement désintéressée. Le travail de l’Atelier, il y a plutôt mis de l’argent, parfois c’est lui qui payait pour l’édition de la revue, souvent il avançait de l’argent pour la location du lieu du séminaire. Sans parler du Méditel qui était un peu la prolongation de l’Atelier, disons un groupe de supervision collective. Louis a animé ce groupe tous les mois pendant trente ans sans aucune contrepartie financière.
- Pratiques : Une transformation des connaissances, mais aussi de soi-même en tant que soignant, ça demande du temps.
Louis défendait qu’en médecine générale, il n’y avait pas d’urgence, on avait le temps puisqu’on pouvait voir le patient autant de fois qu’on voulait bien le lui proposer : ne pas se mettre dans l’urgence et oser proposer au patient de le revoir,
Louis avait aussi une tolérance à ce que les gens fonctionnent autrement. Il pouvait permettre à des patients psychotiques de vivre et de travailler sans être exclus parce qu’il leur accordait sa confiance. Une confiance indéfectible dans les capacités du patient de faire quelque chose de sa vie, de trouver un chemin. Côté médecin, il était également ouvert à des manières différentes d’aborder le soin. Il nous faisait comprendre que ce n’était pas les outils, mais que c’était surtout le désir que nous avions d’aider les patients qui était à l’œuvre.
Jusqu’à la fin, il m’a étonnée. Lors des derniers séminaires, épuisé, il s’endormait parfois un peu, mais de temps en temps il prenait la parole et je me disais c’est incroyable cette finesse et cette pertinence. Il continuait à lire et nous nourrissait de ses lectures, jusqu’au bout il a fait des liens entre ce qu’il lisait, la clinique et les histoires qui étaient racontées là.
Propos recueillis par Françoise Acker, Sylvie Cognard et Anne Perraut Soliveres