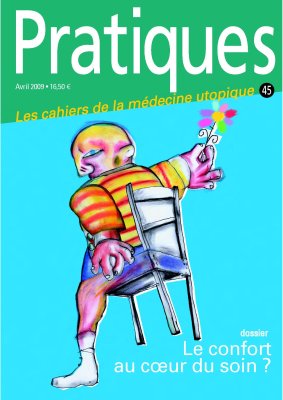Ecouter, accepter la signification que donne le patient de sa maladie contribue àlui conserver une place de sujet, et fait partie du soin.
Il y a quelques années, en salle de garde, un pédiatre, la cinquantaine, me raconte sa première garde aux urgences adultes au cours de son internat. Il me parle d’un patient venant pour une thrombose hémorroïdaire très douloureuse. Le futur pédiatre, après avoir discuté avec le patient et l’ayant examiné, ne sachant pas quoi faire, lui prescrit du Bristopen® (un antibiotique). Après le départ du patient, mon collègue regarde dans ses livres et se rend compte de son erreur.
Quelques semaines plus tard, le même patient revient aux urgences pour la même chose. Là, le médecin se cache, ne voulant pas être vu par ce patient. Celui-ci, le pointant du doigt : « Je veux ce médecin avec ce traitement : Bristope® ». Apparemment cette prescription l’avait soulagé. Comprenne qui voudra !
Ce même pédiatre raconte des visites chez une famille d’origine marocaine concernant un nourrisson qui développe une diarrhée. Cet enfant est le premier-né d’un couple qui vit avec la grand-mère paternelle. Le pédiatre se rend plusieurs fois dans cette famille où il est très bien accueilli, change le traitement mais rien n’y fait, toujours la diarrhée. Et puis un jour, il se tourne vers la grand-mère qui murmure : « C’est un garçon, c’est le premier-né, il va mourir ». En discutant avec cette femme, il apprend que son aîné est mort d’une diarrhée, que sa fille a eu un premier-né mort d’une diarrhée...
Je rends visite à une patiente qui serait atteinte d’une SEP (sclérose en plaque), récemment cette femme me parle de son traitement : « C’est du venin de serpent mais rendu inoffensif, j’en ai besoin pour vivre ». Souvent cette patiente, ressent de l’électricité dans son corps. Souvent cette patiente, quand nous parlons ensemble du quotidien, me parle de « son circuit ».
J’ai rencontré une jeune femme d’origine sénégalaise qui venait d’accoucher. Elle se sentait maussade, voulant rester au lit, demandant de l’aide pour les gestes de la vie quotidienne, se désintéressant de son petit garçon sauf pendant l’allaitement. Cette femme trouvait que c’était son environnement qui « se portait mal » et qui la « déprimait » : « Le boulot, il n’y a que ça, ils n’ont même pas le temps de venir me voir, personne pour m’aider ». Elle avait éjà une petite fille âgée de six ans d’un premier lit, confiée à sa belle famille, qu’elle voyait de temps en temps. Devant le peu de motivation à s’occuper de son enfant, je décide de valoriser toutes les attentions qu’elle lui procure. Au décours d’une conversation, elle m’explique qu’elle est fatiguée, qu’elle voudrait dormir, que l’enfant la dérange. Et puis elle me dit aussi : « Au pays, ce sont les grand-mères qui s’occupent des nourrissons jusqu’à la marche. La maman reste allongée, elle se repose. Des personnes viennent la masser et on lui apporte le bambin pour l’allaitement au sein. » Ici, cette patiente n’avait pas le moral parce qu’elle était confrontée à un système qu’elle ne connaissait pas.
Ce qui lui manquait apparemment, c’était sa propre mère restée au pays.
Les malades édifient des théories qui tentent de rendre compte du rapport à leur corps, des relations entre les organes, des sensations ressenties. Canguilhem (1), à partir de Leriche, a défini « la maladie du malade » : « C’est la maladie du malade qui redevient (...) le concept adéquat de la maladie, plus adéquat en tout cas que le concept de anatomopathologie. »
1. Georges Canguilhem, Le Normal et le pathologique, Puf, ch. 4, p. 52.