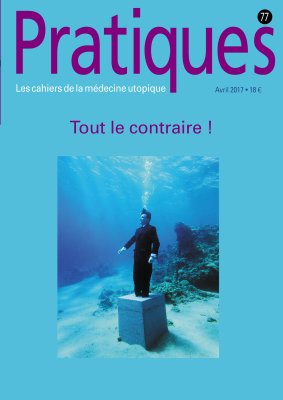Yann Diener
Psychanalyste
-
-
-
- Quand l’administration fait tout le contraire de ce qu’elle devrait faire, il faut lui opposer des paroles contraires. C’est la position que prend l’écrivain Erri de Luca dans son livre La parole contraire (Gallimard, 2015), en s’appuyant sur l’étymologie française du verbe saboter.
-
-
Je travaille à Paris dans un Centre médico-psycho-pédagogique, où je reçois entre autres des adolescents, des lycéens. Lors des manifestations contre la loi travail en 2016, certains lycéens venaient à leurs séances en sortant un moment des manifs. Mais ils étaient souvent bloqués, nassés par les CRS, ils me téléphonaient et j’avais tout d’un coup à l’oreille toute la violence qui leur était faite. Ceux qui parvenaient à venir en séance arrivaient qui le bras en écharpe, qui le visage tuméfié, super-choqués par la violence des charges des CRS alors qu’ils n’avaient fait que chanter des jeux de mots avec le patronyme de la ministre du chômage.
Je travaille aussi dans un Centre médico-psychologique (CMP) pour enfants qui dépend de l’hôpital Sainte-Anne. Pour faire plaisir à l’Agence régionale de santé (ARS), pour donner des gages de petites économies, la direction de l’hôpital a fermé des CMP au cœur de la cité, elle a bousillé des équipes qui faisaient un super boulot auprès des enfants et de leurs familles, elle a déplacé les consultations de proximité dans un bâtiment éloigné et insalubre, humiliant les soignants et les patients en même temps. Et lorsque nous avons protesté, à quelques-uns, nous avons été traités d’agitateurs infantiles, accusés de ne pas participer à l’effort citoyen de réduction des dépenses [1]. Avec des tableaux imbitables et des phrases bourrées de sigles, l’administration de l’hôpital a construit un pseudo-projet pour soutenir (sans y croire une minute bien sûr) qu’ils allaient faire bien mieux que les CMP, avec moins de moyens, en fusionnant, en mutualisant, en rationalisant. Le directeur de l’hôpital nous a soutenu que si les petits patients voulaient vraiment se soigner, ils feraient l’effort de se bouger, de s’organiser, ils accepteraient d’aller loin de chez eux dans des locaux pourris, bourrés d’amiante, avec des ascenseurs en panne et des plafonds suintants les eaux usées, pour aller parler à des soignants humiliés, dépités, logiquement déprimés. Et même devant l’évidence que tout cela a détruit des prises en charge, et donc des familles, la direction de l’hôpital nous soutient le contraire avec le sourire, elle nous dit que c’est beaucoup mieux comme ça, mais que malheureusement nous résistons au changement. Donald Trump n’a rien inventé en parlant de faits alternatifs ou de post-vérité.
Jugé par le tribunal de Turin pour avoir déclaré qu’il était juste de saboter le chantier de la ligne ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin, le poète De Luca répond en s’attaquant à la novlangue utilisée par ses accusateurs : il montre que parler de grande vitesse à propos de cette ligne est un mensonge. Elle ne fera gagner qu’une petite demi-heure par rapport à la ligne déjà en fonction entre Lyon et Turin, au prix de milliards engloutis dans le percement d’un tunnel sous les Alpes, des travaux qui exposeront les ouvriers, les habitants et les policiers présents à des doses mortelles d’amiante et de matières radioactives contenues dans la roche [2].
Erri de Luca, qui a appris le français lorsqu’il travaillait sur des chantiers à Paris dans les années quatre-vingt, aime se référer à l’origine du verbe saboter : la révolte des Canuts, qui pour les enrayer jetaient leurs sabots dans les nouvelles machines à tisser, ces machines qui supprimaient des ouvriers à mesure qu’elles se perfectionnaient. Dans La parole contraire, De Luca revendique l’utilisation du verbe saboter, qui ne peut être réduit au sens d’une dégradation matérielle : il a aussi le sens d’entraver [3]. L’écrivain a risqué la prison, mais il ne s’est pas défaussé pour autant : il a interdit à ses avocats de plaider les circonstances atténuantes, « Parce qu’il ne faut pas atténuer la responsabilité des mots. Les mots ont plutôt des circonstances aggravantes ». C’est la première chose que fait une dictature ou une démocrature, comme dit l’écrivain Predrag Matvejević : affaiblir les mots, imposer un nouvel ordre des phrases [4].
« En dehors du désir de supprimer les mots dont le sens n’était pas orthodoxe, l’appauvrissement du vocabulaire était considéré comme une fin en soi et on ne laissait subsister aucun mot dont on pouvait se passer. Le Novlangue était destiné, non à étendre, mais à diminuer le domaine de la pensée – la réduction au minimum du choix des mots aidant indirectement à atteindre ce but. » [5]
Comment Éric Blair est devenu George Orwell
_Il se trouve que la promotion 2016 de l’École nationale d’administration s’est baptisée Promotion George Orwell. Gageons que ces futurs énarques sont en train de lire tout George Orwell dans le texte. Et pas seulement 1984 ou La ferme des animaux, cette autre critique du totalitarisme stalinien. Ils devraient aussi lire le formidable article « Comment meurent les pauvres » [6]. Ils devraient aussi s’identifier à l’homme derrière le nom de plume : Éric Blair (1903-1950) est né en Inde dans une famille de la moyenne bourgeoisie anglaise, son père étant un fonctionnaire de l’administration des Indes, chargé de la régie de l’opium. Le jeune Éric rentre en Angleterre avec sa mère, il est un brillant élève au très réputé collège Eton, passionné par la littérature. Les cours de littérature française sont assurés par Aldous Huxley – le futur auteur de Le meilleur des mondes. Mais à 20 ans, il s’engage dans les forces de l’ordre colonial en Birmanie. Là il est amené à battre des Birmans, à humilier des vieux paysans, à réprimer les opprimés. Mais il se passe quelque chose. Il refuse de continuer. À l’occasion d’un congé en Angleterre, il démissionne de ce poste. Au grand dam de ses parents, super-inquiets de le voir quitter un poste sûr pour se livrer corps et âme à sa nouvelle ambition : devenir écrivain ! Éric Blair largue les amarres familiales, explore alors les bas-fonds londoniens et se rend à Paris. C’est là qu’il faut être pour écrire : il veut mettre ses pas dans ceux de ses héros en écriture : James Joyce, Hemingway, Faulkner, sans compter les auteurs français. Blair loge dans des chambres crasseuses du quartier latin encore délabré. Il passe son temps à écrire, il produit deux romans, qu’il va détruire aussitôt, et des articles, qu’il essaye avec peu de succès de publier dans des journaux anglais ou français, pour se faire un nom et de l’argent. Mais quand il a mangé tout son pécule, il doit prendre des petits boulots pour payer sa chambre. Il travaille alors comme plongeur dans des hôtels, dans des conditions dégradantes. Il se réjouit de toucher le fond, sans démarche rédemptrice pour autant. Il écrira plus tard que sans le chercher consciemment, il a pu alors s’identifier aux hommes qu’il avait salis en Birmanie.
C’est une transformation qui s’est produite avec l’écriture, et qui a permis l’écriture. Il vit alors un moment comme un clochard dans Paris et, en mars 1929, il est hospitalisé à Cochin pour une pneumopathie. Il se retrouve dans un mouroir infect, alors il s’enfuit sans signer de décharge et rentre en Angleterre, où il va publier Dans la dèche à Paris et à Londres. Mais il ne rencontrera un véritable succès critique qu’avec La ferme des animaux, puis la consécration avec 1984, auquel il consacre ses derniers instants : il meurt de la tuberculose en 1950.
C’est en 1946 que celui qui est devenu George Orwell a publié un essai-reportage-romancé sur son expérience à Cochin, Comment meurent les pauvres. Sa description de la décrépitude de l’hôpital et de la maltraitance des patients est saisissante. Il faudrait réimprimer en plaquette ce texte de vingt pages et l’envoyer en cinquante exemplaires au ministère de la Santé, à l’attention de Marisol Touraine et de ses collaborateurs. Parce que sa politique conduit tout droit l’hôpital public à régresser à ce niveau d’humiliation et de maltraitance que connaissaient les patients en 1929.
Dans Les principes du novlangue, Orwell nous montre comment des torsions opérées délibérément dans la langue – il faut lire le stupéfiant journal de Goebbels pour en trouver une confirmation –, en brisant ou en retournant les mots en leur sens contraire, ou en les écrasant dans des sigles, ne peuvent que contrarier les corps, les pratiques, les métiers, et donc toucher au collectif.
On dit souvent que 1984 – un livre dont les ventes ont connu une hausse de 9 500 % aux États-Unis le week-end où la porte-parole de la nouvelle administration américaine a parlé de « faits alternatifs » pour défendre les mensonges du nouveau président – trouve ses racines dans l’expérience qu’Éric Blair a eue du stalinisme lors de son engagement auprès des républicains dans la Guerre d’Espagne. Mais je pense que ce roman-réel – en particulier en ce qui concerne les actions de résistance qui sont menées dans le monde de 1984 – trouve également ses racines dans l’acte de parole qu’a été la décision du jeune Blair de mettre fin à sa participation à l’oppression en Birmanie.
À l’heure où « la confusion s’établit dans les rapports, pourtant sacrés, fondamentaux, de l’homme et de la parole » (Lacan, 5 mars 1958), il est plus que jamais nécessaire d’opposer des paroles contraires aux éléments de langage et aux faits alternatifs, ces mots écrabouillés qui détruisent nos institutions et nos pratiques.
« Vocabulaire A. – Le vocabulaire A comprenait les mots nécessaires à la vie de tous les jours, par exemple pour manger, boire, travailler, s’habiller, monter et descendre les escaliers, aller à bicyclette, jardiner, cuisiner, et ainsi de suite… Il était composé presque entièrement des mots que nous possédons déjà comme coup, course, chien, arbre, sucre, maison, champ. Mais en comparaison avec le vocabulaire actuel, il y en avait un très petit nombre et leur sens était délimité avec beaucoup plus de rigidité. On les avait débarrassés de toute ambiguïté et de toute nuance. Autant que faire se pouvait, un mot novlangue de cette classe était simplement un son staccato exprimant un seul concept clairement compris. Il eut été tout à fait impossible d’employer le vocabulaire A à des fins littéraires ou à des discussions politiques ou philosophiques. […] »
« Vocabulaire B. – Le vocabulaire B comprenait des mots formés pour des fins politiques, c’est-à-dire des mots qui, non seulement, dans tous les cas, avaient une signification politique, mais étaient destinés à imposer l’attitude mentale voulue à la personne qui les employait. […] Les mots B formaient une sorte de sténographie verbale qui entassait en quelques syllabes des séries complètes d’idées, et ils étaient plus justes et plus forts que ceux du langage ordinaire. […] Ils étaient formés de deux mots ou plus, ou de portions de mots, soudés en une forme que l’on pouvait facilement prononcer. L’amalgame obtenu était toujours un nom-verbe dont les désinences suivaient les règles ordinaires. Pour citer un exemple, le mot « bonpensé » signifiait approximativement « orthodoxe » ou, si on voulait le considérer comme un verbe, « penser d’une manière orthodoxe ». Il changeait de désinence comme suit : nom-verbe bonpensé, passé et participe passé bienpensé ; participe présent : bonpensant ; adjectif : bonpensable ; nom verbal : bonpenseur. »