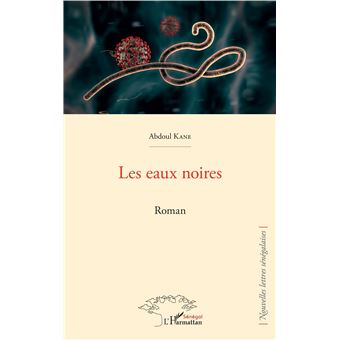
Il y a quelques années, à travers un recueil de nouvelles, La vie sur un fil, nouvelles de mon hôpital, Abdoul Kane levait le voile sur les réalités peu avouables de son hôpital et dévoilait par ricochet le funeste présent des hôpitaux du Continent.
Une dizaine d’années après la sortie en librairie de La vie sur un fil, le tableau de l’hôpital africain peint dans Les eaux noires, nouveau roman d’Abdoul Kane, reste toujours ce marigot inexpugnable où s’affrontent marchandisation des corps, conflit d’intérêts, trafics interlopes et déshumanisation. À ceci près que n’étant pas sûr que dans son premier opus en nous désignant du doigt la lune, nous ne nous fûmes pas attardés à observer son doigt, Abdoul Kane dans Les eaux noires, part du prétexte d’une épidémie (Ebola), et déborde cette fois-ci, la sphère univoque de l’hôpital. Il ouvre le champ des perspectives. Et laisse ainsi transparaître qu’au final l’hôpital est le terminus d’un parcours de vie que rudoient sans merci systèmes politiques délétères, déséquilibre écologique et autres bouleversements climatiques imbriqués à la loi du marché. Adversités qui vont de pair avec des politiques d’emprunt susurrées par les experts internationaux, extorquant sans appel l’initiative endogène des communautés.
Les eaux noires, roman foisonnant, nous fait culbuter de son rythme syncopé dès l’incipit, dans Darkunda, hideuse cité poussée spontanément à la faveur de la guerre, du dénuement, du crime, du vice et de la soif du lucre.
A Darkunda, le sens de la vie importe peu au regard d’une vitalité qui tourne vite en une fête de la survie au quotidien. A peine commence-t-on le livre que surgit au marché de Darkunda, un lépreux sorti d’un autre âge, fourrageant les poubelles, se disputant une nourriture infecte avec les rats. Au milieu des victuailles et de la pacotille haute en couleur venue de Hambourg, de Chine, de Lagos, des chasseurs éclaboussés de sang et devenus bouchers pour la circonstance, font étalage de leur gibier faisandé parmi une nuée de mouches babillardes. A ciel ouvert, Seikouba le politicien véreux adulé d’un troupeau de « militants alimentaires » prêts à vendre leur conscience au plus offrant, tient meeting. Plus loin, une ribambelle de diablotins dans l’innocence de leur âge batifole à cœur joie dans une piscine d’eaux putrides chargées d’étrons, de charognes, de nénuphars (les eaux noires).
Dès l’entame du bouquin, le ton des vraies interrogations est donné !
Quand défection de l’Etat et délitement du lien social vident les communautés de leur âme
Au premier abord, Darkunda paraît être une cité née dans le péché et vouée à une inexpiable malédiction. Avec autant d’éléments du désastre que sont Karapass le transport en commun, Jamot l’hôpital, Douglass l’alchimiste et trafiquant de carbures, Tosh l’herboriste assuré …
Karapass, le taxi-brousse qui dessert la région de Darkunda est plus que parlant. Taco de bric et de broc agrémenté de gris-gris, flamboyant de fresques du Ché , de Sankara, de Bob Marley et de Kadhafi. Alliage mystico-technique que pilote Salifou, orphelin de guerre, bâtard d’une mère prostituée et d’un père riche commerçant assassiné, lui-même ancien braconnier, enfant de la rue ayant survolé l’école et gravi tous les échelons de la délinquance, et gardant en aversion la mendicité et les vols à la tire qu’il considérait comme menu fretin.
Jamot, comble de damnation ! Jamot l’hôpital, quant à lui est une relique pustuleuse de la période coloniale. Jamot s’invite au paysage dantesque de Darkunda avec des malades qui y arrivent en charrette, en taxi-brousse, rarement en ambulance. A Jamot, pas d’eau potable. Pas d’alcool. Pas de Bétadine. Pas de matériel jetable. Tout est réutilisé. Les gants portés plus de 10 fois.
Les parages de Jamot sont une innovation : un supermarché ambulant, réplique parfaite du marché de Darkunda avec ses marchands de lait de contrebande, de médicaments contrefaits, d’écorces mystiques, de talismans et de poudre magique, de potions lustrales, de philtre d’amour, d’agrandisseurs de fesses, de griffes de panthère, de sabots d’antilopes, de peaux de serpent, d’excréments de chauve-souris, de tête de singe et autres restes d’animaux que les braconniers bradaient à vil prix.
A Darkunda pour compléter le sinistre décor, il fallait également un journaliste. Et il y eut Théo le journaliste de malheurs. Sacré Théo ! Une nullité. Théo reniflait les per diem de l’information et les raflait à fond de train. Chassait des ragots mensongers qu’il savait assaisonner à sa sauce, les amplifiait. Il avait l’art de mettre les feux aux poudres, de raviver les conflits entre politiciens, entre communautés.
Parmi cette engeance propre d’une cité en perdition, il ne pourrait ne pas y avoir également Femi. Femi avec son échoppe pompeusement rebaptisée « Banque centrale ». Fémi, un banquier déchu, devenu usurier et fabriquant de faux billets à ses heures.
Il n’y aurait pas de Darkunda sans un maître des lieux : Sheik Douglas ! Ancien trafiquant d’essence et de gasoil, trempé dans une affaire de forage clandestin et de fûts vendus à la sauvette, origine d’un incendie ayant calciné une ville entière. Douglas contraint à l’exil, se reconvertit en préparateur en pharmacie. Profession trop conventionnelle pour un homme du calibre de Douglas ! Il choisit donc de se terrer à Darkunda pour la vente de carbures bon marché et de breuvage d’une alchimie nébuleuse et d’une chimie suspecte. Et il ne saurait y avoir de Douglas sans Mister Tosh ! Son voisin et concurrent, vendeur d’herbes bénites avec qui il est toujours à couteaux tirés.
Quand l’Etat est défaillant et qu’il se dérobe à ses fonctions régaliennes d’ordre public, de justice et d’équité sociale, comme à Darkunda, il faut s’attendre au pire : crises sociales, politiques, sanitaires, ethniques…
À l’échelle individuelle, il faut s’attendre à cet individualisme sur le point de faire disparaître Darkunda. A cette soif du lucre et du profit qui finissent par devenir la règle. A ce sentiment d’appartenance à une communauté qui part en fumée.
Aux écosystèmes sociaux qui partent en éclats.
Au gré des stigmatisations, il n’y aurait donc plus qu’un pas à faire pour entériner l’assertion suivant laquelle une malédiction digne des récits bibliques avec ses nuées de sauterelles, de moustiques et ses eaux sales, serait en train de s’acharner sur Darkunda. Darkunda n’était pas seulement royaume de camarilla et d’affameurs, bauge à vermines, Darkunda pour combler ses dix plaies d’Egypte, était subitement devenue le théâtre d’une épidémie qui fauchait des vies, pourrissait ce qui y restait encore de vie :
« Ici à l’angle d’une rue et à côté d’un tas d’ordure, une femme a été trouvée morte au milieu de ses sécrétions, accompagnant un fœtus macéré ; là un monceau de corps en décomposition ; plus loin, un adolescent les habits imbibés de sang et de selles, gémissant en annonçant sa propre fin, affalé devant la porte de l’hôpital Jamot sous le regard de badauds sidérés, désabusés, ou impavides. A quelques mètres un cadavre est traîné par quatre gaillards vers la morgue via une ruelle à l’abri des regards indiscrets. Les morts à domicile s’enchaînent… »
Faut-il pour autant jeter Darkunda aux gémonies d’une malédiction ? Ou reconnaître purement et simplement l’irresponsabilité d’Etat et autres iniquités dont elle est victime ? » [1]
Avec cette épidémie, s’enclenche pour Darkunda une autre descente aux enfers.
Une autre épidémie se déclare, celle des rumeurs et du déni de la maladie :
« C’est une tentative d’extermination (l’épidémie) après avoir tout essayé : l’esclavage, la colonisation, la néo-colonisation, le Sida, les guerres tribales, la dévaluation de nos Cauris France Afrique (monnaie)… Maintenant, ils fabriquent des terroristes et suscitent quelques guerres pour vendre leurs armes ; en plus, cela leur permet de venir surveiller nos puits de pétrole et nos mines d’or, de diamants et d’uranium. As-tu seulement vu Ebola dans un pays qui ne possède pas de minerais ? » [2]
Puis vint le confinement avec ses gigantesques barbelés rouges encerclant Darkunda. Les miradors dotés de lumière vive surveillant la banlieue avec sa populace. La ceinture plus militaire que sanitaire. Les hommes en treillis plus nombreux que les hommes en blouse blanche, les Kalachnikovs plus visibles que les thermoflash, les matraques et grenades plus nombreuses que les stéthoscopes.
Mesures destinées non pas à protéger la populace victime de Darkunda mais pour séparer, mieux séparer Darkunda de la Marina. Marina, quartier chic de la ville, hébergeant les députés, hauts cadres, hommes d’affaires opulents aux mains et l’honorabilité blanchies par les vertus d’une fortune puisée dans la vente des stupéfiants ou bâtie sur le détournement des maigres ressources du contribuable.
Florissantes étaient également les affaires !
Alors que l’épidémie s’étendaient aux villages voisins, des familles fuyaient dans la forêt créant des refuges qui deviendront leurs propres charniers, des révoltes dramatiques éclataient entre les villageois et les administrateurs locaux.
Alors que se perpétraient tous ces drames, euh oui, les affaires étaient florissantes ! A défaut d’ambulances, Salifou montait les enchères pour son taxi-brousse, Karapass devenait une ambulance de circonstance. Un réseau se mit en place : Seikouba le politicien véreux, Fémi l’usurier en complicité avec des fonctionnaires du ministère la Santé et du Sida gagnèrent le marché des thermomètres à infrarouge, du gel antiseptique et des seringues à usage unique. Des ONG virent le jour gonflant les statistiques de la misère et récoltant des fonds au nom des malheurs d’une population en déshérence. Des orphelinats ouvrirent les portes. Des grosses voitures rutilantes firent leur apparition dans Darkunda.
Au nom d’un prétendu enterrement digne et sécurisé, les familles n’avaient pas accès à leurs morts. Ils étaient récupérés et mécaniquement enterrés par des hommes en combinaison sans la moindre prière. Ces âmes en peine erraient dans le village en quête d’une hypothétique paix.
Des pépites d’humanité sous le rouleau compresseur
Avec un assortiment de tels spoliateurs tout prêterait à croire qu’à Darkunda plus aucune personne n‘incarnait une grandeur morale favorable à l’épanouissement de notre appartenance commune à l’humain. Il fallait pourtant aller chercher du côté de ces créatures humaines qui n’avaient rien de théâtral, pressurées et laissées à l’abandon.
Il y avait en l’occurrence dans la rue, Maria, cette vendeuse de beignets. Ayant perdu ses parents très jeune au cours d’une guerre interreligieuse, elle fut spoliée par son jeune frère, Seikouka le politicien véreux. Malgré les tribulations que connut sa vie, Maria était restée digne et fière ne cédant à aucune compromission. Elle avait pris sous sa protection Petite M’an qui l’appuyait dans son restaurant. Petite M’an était une fille-mère qui eut son premier bébé à l’âge de treize ans, et dont les deux grossesses suivantes perpétrées par le même pédophile, se compliquèrent de fistule vésicale, laquelle fistule lui valut dans tout Darkunda le surnom assassin « d’urinoir itinérant », de « WC public », de « pisse ambulante »… Le restaurant était un lieu de liberté où les citoyens se retrouvaient pour parler des problèmes de la cité. « Le comptoir d’un café est le parlement du peuple », disait à juste titre Balzac.
Dans le même ordre d’idée, il y avait Bernard, jeune médecin brillant, issu de la haute bourgeoisie française. Bernard troqua une brillante carrière universitaire offerte sur un plateau doré via les relations de son père avec les grands patrons de la médecine française contre une carrière de médecin humanitaire. Le pauvre croyait vraiment pouvoir sauver une Afrique à vau l‘eau, des ravages du Sida, de la bacillose, de la malaria, ou du vomito negro. Et Ebola était un excellent champ de bataille. Sauf qu’en refusant de jouer à l’humanitaire de salon et des officines, Bernard ne tarda pas à laisser des plumes partout où il passait. Il se surprit au final en train de broyer du noir.
Quant à Sorbonne, il était le genre d’érudit se nourrissant de science et d’eau fraîche. Après son baccalauréat, il partit très jeune en France pour ses études. Il courut le monde. Et ne rentra au bercail que des dizaines d’années après, bardé de diplômes dans des domaines aussi variés que l’épidémiologie, l’astronomie, la physique, la philosophie. Poète désargenté, il n’en avait que faire des biens matériels. A peine arrivé, il fut victime des railleries les plus vexatoires. Il subit des rapines. Fut jeté en hôpital psychiatrique où les « camisoles chimiques le plongèrent dans des longues catalepsies… Jusqu’à ce qu’éclose l’épidémie d’Ebola, il n’eut aucun interlocuteur qui prêtât attention à ses bouffées de poésie illuminée.
A travers un personnage tel que Satigui le sorcier, malfamé et réduit à l’insignifiance par les temps qui courent, Abdoul Kane assène à l’aéropage de nos scientifiques une ordinaire leçon de méthode. Fadas de la pensée analytique, nos scientifiques prennent de haut nos ressources intuitives endogènes. Oubliant que celles-ci coulent de source depuis les nappes phréatiques infinies de notre inconscient et imaginaire collectifs. Henri Poincaré ne soutenait-il pas que : « C’est avec la logique que nous prouvons, et c’est avec l’intuition que nous trouvons. »
Aux prémices de l’épidémie d’Ebola, alors que les scientifiques peinaient à identifier l’origine du mal, des éléments de langage transparaissaient déjà dans le flot des paroles embrumées de Satigui (singe, chauve-souris, une maladie de la forêt).
Nos scientifiques rataient-là un précieux raccourci qui aurait contribué à éviter des morts.
La rédemption ou l’initiative endogène reconquise
Darkunda avait l’air d’une léproserie, une nécropole à ciel ouvert, champs d’apocalypse où circulaient tourmentées les âmes en peine. Cancans et acrimonieux ragots tenaillaient de toutes parts le faubourg abandonné sur la paille. Les habitants de Darkunda et leurs flopées d’orphelins désorbités, ressemblaient à des proscrits assignés à une damnation sans appel. La cité était la proie d’une hostilité telle qu’on se demandait comment Darkunda avec sa progéniture, pour ne parler que de celle-ci, allait s’en sortir. Les adultes sortaient de ces épreuves, le souffle enserré dans des corps meurtris, momifiés.
Et ne voilà-t-il pas que, dans les interstices de cet enfer, surgissait un homme, ayant perdu dans la bourrasque de l’épidémie son neveu et sa tante, Doe qu’il s’appelait !
Doe était un garçon déluré, ayant fait des études honorables, rompu à l’école de la vie. Il avait fait le choix des marges, préférant vivre au village parmi les siens, pour qui il se rendait disponible pour la rédaction de courriers, pour les transactions avec l’administration et pour aider à monter les projets.
Contre toute attente, Doe interpela instamment le village qui végétait dans une longue analepsie. Il l’interpela à puiser dans le secret profond de son âme pour se requinquer, se remettre debout.
Finis les sauveurs internationaux !
« Dans les ennuis, les tracas, l’homme est seul. Une fois que l’on est dedans, on doit s’en sortir par soi-même, pas de sauveurs pour s’occuper de ces vétilles. » disait Gao Xingjian.
Doe haranguait le village atone et amorphe :
« nous avons été assistés comme des grands enfants cinquantenaires, nous nous sommes évertués à regarder là où d’autres nous font regarder, car c’est le sens de l’histoire qu’ils ont décidé d’écrire pour nous. Aujourd’hui, alors qu’on nous a tendu une corde du fond de notre puits noir, nous peinons à nous en sortir. C’est bien la preuve que nous n’avons appris qu’à creuser des trous dans notre beau terroir où Dieu a tout mis. Allons-nous donner raison à ceux qui disent que la Terre est bénie mais les hommes sont maudits ? » [3]
Dans cette communauté où l’argent-roi avait complètement désintégré le tissu social, les répliques contre Doe ne tardèrent pas à fuser de partout :
« Où vas-tu trouver les milliards d’euros et de dollars ? Aurais-tu récupéré de l’argent planqué dans quelques paradis fiscaux ou as-tu trouvé quelques-uns des trésors des pirates du Golfe de Guinée ? » [4]
Mais c’était sans compter avec le charisme de Doe !
« Où est Amidou le puisatier ? » Lança Doe.
Et illico presto, ces mots eurent un pouvoir perfectif.
Sans rechigner, Amidou se rendit avec sa tenue et son instrument de travail. Il fallait commencer par creuser un puits. L’eau c’est la vie, l’eau purifie, désaltère, lave, sert à cuisiner…
Et par un incroyable effet domino, les choses allèrent très vite.
Douglass le vil empoisonneur se rangea. Car bien dosé son mauvais vin allait devenir un excellent désinfectant. Après quelques tergiversations, Tosh, l’autre affairiste et concurrent juré de Douglas rejoignit ce dernier pour la bonne cause. Ils étaient les deux alchimistes attitrés de Darkunda, seuls capables de superviser la désinfection de l’eau !
Morgan, un jeune tailleur du village connu pour ses difficultés en calculs et en mesures, se fit aider par Sorbonne le philosophe, poète, astro-physicien, épidémiologiste et mathématiciens dans une ancienne autre vie. Morgan l’artisan, Sorbonne l’artiste, un couple original ! Il avait charge de confectionner les combinaisons de protection pour l’hôpital.
Les docteurs Kamara, Bernard et Alkali travaillaient à réorganiser l’hôpital.
Patite M’an, Zeinab et Liliane nettoyaient les trois grands hangars pour héberger les malades.
Et c’était à qui mieux mieux que Sliman et Kourouma, les instituteurs, formèrent les enfants pour le renfort de la prévention.
Les gamins, chapardeurs, toxicomanes et autres lardons de Darkunda rôdés à l’école de la vie s’occupèrent du marché, de la piscine…
Seikouba le politicien véreux, Fémi l’usurier et tenancier de la « Banque centrale », Théo le journaliste de malheur fournirent au village équipements, nourriture et eau.
Dans un élan de syncrétisme spontané, Frère Paul le prêtre, Malick l’imam, Manaissara le sorcier et Tai Li, perchèrent ensemble pour rétablir les valeurs d’humanité.
D’instinct, cette prise de conscience inattendue se doubla d’une conviction profonde de collectivement se faire fort pour l’intérêt du village. Et dans cet élan d’oubli de soi, chacun jouait sa partition, cherchant à apporter le meilleur de lui-même. Les plus valides veillaient sur les plus vulnérables.
Ainsi au moindre symptôme, les malades accompagnés de leurs familles ne tardèrent guère à se rendre à l’hôpital, ce qui permit à docteurs Kamara, Bernard et Alkali d’être efficients.
L’hygiène du village fut au top grâce aux solutions javellisées de Douglass. Les combinaisons de Morgan et Sorbonne taillées sur du matériau jusque-là ignoré tel que des résidus de récupération, eurent leur effet. Frère Paul, l’imam Malick et Manaissara priaient pour les morts qui retrouvèrent enfin leur quiétude. Les habitants consommaient des légumes et des fruits du cru. L’aide internationale ne venait plus pour supplanter l’initiative endogène. Elle ne faisait qu’accompagner celle-ci.
Inspiré de l’épidémie d’Ebola, Les eaux noires est un roman du vivant. Publié en mai 2020 soit deux mois après la déclaration du premier cas de COVID-19 dans le continent africain, il est impossible de ne pas y lire une certaine teinte de prémonition, à l’aune de ce qu’allait vivre l’humanité entière dans les trois années qui suivirent la sortie de ce roman.
L’humanité qui semblait, depuis la Grippe espagnole, avoir relégué aux oubliettes le supplice de pareilles pandémies, avait bel et bien des choses à apprendre de l’expérience avant-coureur de Ebola. A bien lire Abdoul Kane dans ces Eaux noires, l’on se rend compte que toutes les péripéties que vécut l’humanité durant la pandémie de COVID-19, sont en tous points, celles-là même qu’une petite banlieue africaine vécut auparavant avec Ebola. Malheureusement le paradoxe de notre monde à la fois interconnecté et de plus en plus fragmenté, replié dans les communautarismes et autres nationalismes, a fait en sorte que l’Humanité s’est fait prendre de court par une menace qui planait depuis déjà une vingtaine d’années sur notre monde.
Cette dernière fiction d’Abdoul Kane a le génie de se placer au confluent de plusieurs problématiques de santé tel la réappropriation de l’initiative endogène, la Communication du Risque pour l’Engagement des Communautés (CREC), l’approche One Health, la médecine holistique …
A l’heure où notre planète est et sera de plus en plus exposée aux urgences sanitaires, joignez l’utile à l’agréable, et faites-vous plaisir en lisant « Les Eaux noires », roman d’une écriture charnue et jouissive !
Article au format pdf téléchargeable :



