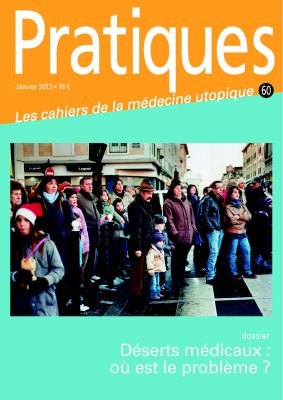Zoé Michel,
Étudiante en médecine
Je me suis engagée dans les études médicales dans le but de devenir médecin généraliste. J’étais attirée par l’aspect scientifique de la discipline, mais essentiellement par son côté social.
C’est la relation privilégiée entre le médecin traitant et son patient, qu’il suit au long cours, qu’il connaît et qu’il prend en charge dans sa globalité d’être humain qui m’a fascinée et qui m’a poussée à me lancer dans ces études. C’est un choix que j’ai beaucoup réfléchi, avant même d’y être. Je vis mon futur métier comme un engagement militant, et il me paraissait évident que j’irais m’installer dans les zones où on aurait besoin de moi.
Assez rapidement, le problème du financement de mes études s’est posé. Je travaillais l’été depuis mes 17 ans, et j’ai également travaillé à temps partiel au cours de l’année universitaire, j’ai fait un tas de petits boulots : manutention en usine, vente de prêt-à-porter, un service civique dans une association, chargée d’assistance en centre d’appels... Mais mener les deux de front était compliqué, d’autant plus à partir de l’externat où il n’y a plus de vacances l’été et beaucoup trop de travail pour se permettre de prendre un temps partiel. Pour autant, je ne suis pas issue d’un milieu modeste, ma mère est institutrice et mon père agronome. Classe moyenne, trois petits frères dont certains commencent à entrer dans les études supérieures, les loyers qui vont avec, juste assez d’argent pour être au-dessus des plafonds de bourses... Et des études longues et chères, entre le matériel, les livres, le coût de la vie... Ce que je raconte là n’est que la réalité d’un grand nombre d’étudiants, qui ne sont pas forcément engagés dans des études médicales.
Lorsque j’ai entendu parler du Contrat d’Engagement de Service Public (CESP) la première fois, il y avait tellement peu d’informations à ce sujet que je ne l’avais pas réellement envisagé comme une solution. Puis en octobre 2011, ma faculté a organisé une réunion d’information à laquelle je me suis rendue et au cours de laquelle j’ai pu poser mes questions. Être médecin généraliste et aller en zone dite désertifiée, c’était déjà mon projet. Par contre, à 20 ans, il est compliqué de se fixer sur un territoire en particulier et s’engager à y rester dix ans. L’avantage majeur de ce dispositif, et ce qui m’a décidée à signer, est qu’on ne nous demande pas cela. Je dois m’engager dans la région où j’effectue mon internat, et j’ai le choix de mon lieu d’installation parmi une liste de (nombreuses) zones ciblées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) comme déficitaires ou prochainement déficitaires. À l’internat, nous choisissons parmi des places réservées aux étudiants en CESP, proposées en fonction des besoins, essentiellement de la médecine générale, mais aussi quelques autres spécialités. Après y avoir beaucoup réfléchi, j’ai présenté un dossier, j’ai eu un entretien à l’ARS et j’ai été retenue. J’étais alors en troisième année. J’ai donc signé ce contrat par effet d’aubaine, cela n’a pas modifié mon projet professionnel, ça l’a simplement rendu plus concret, et ça a surtout grandement amélioré ma qualité de vie actuelle. Pour l’instant, je ne le regrette absolument pas.
Mais je note quand même des choses contestables dans ce dispositif, et elles ne concernent pas mon cas particulier, mais l’idée générale dont il provient.
La première, évidente, est que les seuls qui renoncent à la sacro-sainte liberté d’installation sont ceux qui ont besoin d’argent... Dans les faits, c’est aussi probablement ceux, dont je fais partie, qui n’y sont pas spécialement attachés, voire qui ne la trouvent pas légitime face aux problèmes d’accès aux soins actuels. De mon point de vue, nous sommes une corporation qui jouit de très nombreux privilèges : des rémunérations confortables, une forte reconnaissance sociale, aucun problème d’accès à l’emploi... Nous sommes formés par l’hôpital public et nous sommes rémunérés, en majeure partie, par la Sécurité sociale et donc par les cotisations de nos concitoyens. Il me paraît donc normal que face à tant d’avantages, nous ayons aussi des engagements vis-à-vis de la société, notamment celui d’être là où il y en a besoin. C’est le cas d’autres professions d’intérêt général, comme les professeurs par exemple, qui jouissent de bien moins de privilèges et qui ont bien plus de contraintes, et ça semble légitime pour tout le monde...
La deuxième qui me frappe est que ce n’est en aucun cas une réponse pérenne au problème de la désertification médicale. D’une part, par le nombre très limité d’étudiants qui signent ce contrat par rapport aux besoins, et d’autre part car cela élude une grande partie des différentes problématiques de la « désertification médicale », notamment l’organisation générale du système de soins, la difficulté croissante d’accès aux services publics en zone rurale, le défi démographique du vieillissement de la population auquel nous sommes confrontés, etc.
En bref, je pense que ce n’est absolument pas une réponse adaptée à l’ampleur du problème, mais pour moi, et d’autres étudiants, c’est une solution immédiate satisfaisante bien qu’imparfaite.
Dans un avenir idéal, je me vois salariée du service public de santé, donc plus exactement fonctionnaire du service public de santé, avec un salaire fixe, travaillant en maison de santé pluridisciplinaire avec d’autres professionnels. Je ne veux pas m’installer seule, d’abord parce que j’aime travailler en équipe, mais aussi et surtout parce que je fais partie de ces futurs médecins qui ont envie de se passionner pour leur métier, de s’y engager pleinement, mais qui ont aussi envie d’avoir une vie « normale », c’est-à-dire d’avoir le temps de vivre à côté, d’avoir des loisirs, du temps à passer avec leurs proches... Ce n’est pas d’un traitement de faveur comme une augmentation de la rémunération, le droit de dépasser les tarifs conventionnés ou je ne sais quel autre enfumage dont j’ai envie. J’ai envie de pouvoir prendre en charge mes futurs patients correctement, dans un système de santé qui fonctionne, avec un financement pérenne, avec des conditions de travail décentes et des conditions de vie agréables : des transports publics, des centres de soins de proximité, une offre culturelle, des écoles...
Pour ce qui est de mon lieu d’installation, je ne suis pas fixée. Je souhaite rester à l’ouest de la France, car c’est la région que je connais et là où se trouve la majorité de mes attaches. J’ai des envies d’Ariège, car c’est une région que je connais et que j’adore, mais j’ai aussi d’autres idées... J’ai encore plus de deux ans avant de faire le choix de la région de mon internat, je vais les utiliser pour y réfléchir posément.
Pour ma génération de futurs médecins, nous allons arriver dans la vie professionnelle à un moment compliqué. Plutôt que s’arc-bouter sur les classiques revendications corporatistes, il serait intéressant de soulever les vrais problèmes. Celui des conditions de travail, d’abord, car nous sommes nombreux, aujourd’hui, à ne pas vouloir nous sacrifier pour notre métier et pour autant à avoir très envie de l’exercer, et de bien l’exercer. Celui de l’accès aux études médicales (et aux études supérieures en règle générale d’ailleurs) qui sont longues, coûteuses, et peu à la portée des personnes issues de milieux populaires, ce qui de mon point de vue favorise l’endogamie et les revendications corporatistes peu légitimes que tout le monde connaît. Celui de notre système de soins, de son organisation et de son financement. Ne pas être des citoyens et des travailleurs à part, avec des règles à part, mais être comme les autres tout en étant conscients de la place particulière et du rôle qui devrait nous incomber d’être les garants d’un système de soins juste, efficace et accessible à tous. À mon sens, la médecine à défendre n’est pas un statut social privilégié, mais un engagement, solidaire et militant. Le CESP me permet simplement d’avancer vers cet objectif confortablement.