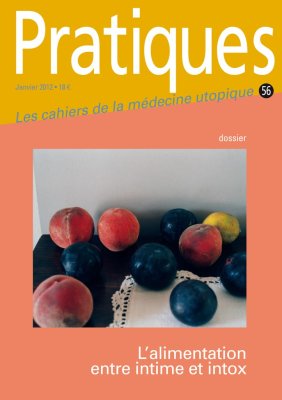Chandra Covindassamy
Psychiatre, psychanalyste
Dans des sociétés où la consommation est un des enjeux, voire l’enjeu majeur, la suppression par la destruction des restes est considérée par beaucoup comme la norme. Qui n’a pas eu connaissance de la pratique d’incinération des restes alimentaires laissés par les touristes nantis dans des pays où une portion notable de la population souffre de malnutrition ? Dans des pays économiquement développés, les restes alimentaires non vendus sont rendus impropres à la consommation, par exemple en les aspergeant d’eau de Javel.
Ces pratiques de destruction ont, bien sûr, un versant choquant si l’on prend en compte les différences des conditions de vie des uns et des autres, mais un autre aspect mérite d’être mentionné. Ces destructions, toujours cachées, peuvent conduire à l’idée selon laquelle il n’y a pas de restes, ou même qu’il n’y en a jamais eu, voire que la notion de restes n’existe pas. C’est du moins l’impression qui se dégage lorsqu’on fréquente les médias dits de masse et on peut même se demander si la croyance illusoire selon laquelle on pourrait se nourrir sans laisser de restes n’aurait pas un rapport avec une certaine augmentation des troubles du comportement alimentaire, en venant accréditer l’idée selon laquelle la quantité de nourriture ingérée ne serait réglée que par la contenance d’un sac imaginaire.
Il existe des civilisations où la question des restes, ou plutôt la notion même de reste, loin d’être un impensé, est au contraire au cœur des questions toujours très complexes auxquelles l’être humain est confronté lorsqu’il s’agit de manger.
Tel est le cas, mais ce n’est sans doute pas le seul, de la culture indienne brahmanique hantée par la question de la pureté et par conséquent de la souillure. Rites et sacrifices ont pour fonction de border cette question incessante. Une nourriture souillée souillerait celui qui la mange. La conclusion, en apparence paradoxale, à laquelle l’élaboration complexe et rigoureuse des textes védiques conduit, pourrait s’énoncer très schématiquement ainsi : pour échapper à la souillure, l’être humain ne saurait manger que des restes des sacrifices ou des offrandes faits aux dieux. C’est-à-dire que seulement peut être mangé ce qui aurait pu être une offrande selon un rapport métonymique. Bien évidemment, cette conception est adéquate au système des castes selon lequel les moins purs peuvent manger les restes des plus purs. Mais comme tout système, il n’est pas exempt de contradictions sources de problèmes logiques, par exemple un disciple peut manger les restes de son gourou, mais le gourou lui-même mange, d’une certaine façon, les restes de son disciple puisque ce dernier pourvoit à la subsistance du maître... Si on accepte de mettre de côté une position de jugement, l’intérêt de ce mode de rapport est de mettre la notion de reste au cœur de l’échange.
Deux abords radicalement différents de la notion de reste, dans un cas c’est l’existence même d’un reste qui permet de se nourrir, alors que dans l’autre le reste est quasiment un impensé sous-tendant l’imagination d’une nourriture sans restes.
En préparant ce texte, j’avais en tête d’une part la réalité du gaspillage alimentaire à l’échelle de la planète : actuellement, un quart de la nourriture produite serait jeté sans avoir été consommée. Et d’autre part le fait qu’à une époque, pas si reculée que cela, disons il y a un peu plus de cinq décennies, il existait un certain interdit à jeter de la nourriture et un tabou quasi absolu à jeter du pain (qui était consommé le cas échéant sous forme de pain perdu, de chapelure, de croûtons, de pudding...). Sur ce dernier point, mon propos n’est pas d’alimenter une nostalgie ni de susciter des explications (la guerre et le rationnement et aussi le mode de vie rural encore proche pour beaucoup), mais de mettre en évidence le statut différent des restes à une époque où tous les foyers, loin de là, ne disposaient pas de réfrigérateur.
La question de la place des restes conduirait donc à opposer deux conceptions du rapport à la nourriture, l’une « archaïque » prenant en compte les restes et l’autre « moderne » les détruisant. Mais alors que je cherchais des éléments de documentation sur Internet, j’ai eu la surprise de découvrir, en entrant dans la machine : « restes », des sites très actifs consacrés précisément à l’utilisation des restes alimentaires. Dans ces sites, on trouve des conseils sur les façons de conserver dans de bonnes conditions d’hygiène les restes alimentaires et surtout, si l’on inscrit les restes dont on dispose, des recettes sont proposées pour les accommoder. Certains sites plus spécialisés proposent des recettes conformes à des prescriptions religieuses.
En poussant un peu plus avant la recherche à partir de l’entrée « restes alimentaires », un site destiné spécifiquement aux gestionnaires de collectivités explique comment, dans ce contexte-ci, le simple don de nourriture non consommée engage gravement la responsabilité de celui qui donne.
Dès lors une autre problématique se fait jour : le statut des restes est très différent selon qu’il s’agit de restes domestiques qu’il est licite d’accommoder pour son usage personnel ou de restes de nourriture faisant l’objet d’un échange commercial. La ligne de partage entre ces deux statuts des restes se fait selon l’implication même potentielle de l’argent dans la mise en circulation de la nourriture en question.
En d’autres termes, les restes domestiques peuvent constituer les ingrédients d’un autre plat selon l’inventivité ou le talent de la ou du cuisinièr(e). Alors que les restes, et donc la nourriture, venant directement d’un échange monétaire ont le statut de marchandise devant donc générer du profit. Dans cette logique, les excédents ne générant aucun profit ne peuvent qu’être détruits.
Ces deux statuts du reste correspondent assez bien à la distinction opérée par Karl Marx dans ses textes de jeunesse, puis par Georges Bataille entre « économie générale » qui prend en compte l’ensemble des modalités des relations entre les êtres humains et l’« économie restreinte » dans laquelle seuls sont pris en compte les échanges impliquant de l’argent.
Sur Internet :
Gaspillage alimentaire : www.ecoconso.be › Alimentation
Reste frigo : de très nombreux sites pour accommoder les restes. Le point de vue de gestionnaires de collectivités : gestionnaires.actifforum.com
Sources :
Charles Malamoud, « Observations sur la notion de “reste” dans le brahmanisme » in Cuire le Monde, éditions La Découverte, Paris, 1989. Georges Bataille, La Part Maudite, éditions de Minuit, Paris, 1967. Les glaneurs et la glaneuse, réalisation Agnès Varda, 2000.
Ce texte a suscité de la part du comité de lecture de nombreuses réactions qui ne peuvent pas être reproduites ici faute de place. Malgré tout, voici des extraits de trois d’entre elles résumant bien la teneur des échanges ; en remerciant tous les intervenants.
C. C.
• Jean-Pierre. Lellouche
Cet article sur les restes m’évoque le fait de ne pas faire de restes et de finir son assiette.
Mes parents exigeaient de nous que nous finissions nos assiettes et en tant que parent, j’ai toujours exigé (ou incité ou souhaité fortement) que mes enfants finissent leur assiette.
Je suis peut-être très rétro, mais il me semble que l’enfant et les parents doivent avoir une idée approximative de ce qui sera mangé. L’assiette est donc remplie en fonction de cette évaluation approximative intuitive.
On peut bien sûr des fois se tromper un peu, mais globalement, l’idée générale est que l’assiette doit contenir ce qui sera mangé. Il y a là comme une pédagogie répétée de la différence entre désir et besoin. Je crois d’autre part qu’il existe un lien entre cette « discipline » et la prévention des pratiques addictives.
L’enfant roi décide au moment où il mange de manger beaucoup ou peu, il surprend son entourage, il est le maître. Dans le rite qui consiste à prévoir ce qui va être mangé, l’enfant perd sa « royauté » sur ce plan, pour le bien de tous.
• Frédéric Launay
J’ai eu exactement la même éducation pour des raisons « morales » qui reposaient sur plusieurs principes :
1. On prend de tout, un peu, même quand on n’aime pas parce que tout ce qui est cuisiné est comestible et que le goût s’éduque.
2. On finit son assiette parce qu’on doit faire honneur à ceux qui l’ont préparé (et l’on finit son pain aussi !) Les repas étaient (et sont toujours) intégrés dans une logique communautaire qui impose un équilibre entre désirs et goûts personnels, partage collectif et codes relationnels de respects mutuels, ainsi que dans un environnement écologique de renouvellement cyclique. Les restes et leur utilisation sont donc le résultat de ces multiples influences qui font que selon les contextes, je me ressers alors que je n’ai plus faim ou je me prive alors que je crève la dalle !
• Pierre Volovitch
Calicoufettes
Quand ma grand-mère reconstituait un plat à partir de ce qui était resté dans les casseroles des repas précédents — évidemment pas à partir de ce qui était resté dans nos assiettes, puisque, par injonction incontournable, il ne restait rien dans nos assiettes — donc quand elle avait reconstitué un plat avec des « restes », nous mangions des « Calicouffetttes » [1]. Et c’était très bon.
À partir du papier de Chandra sur « les restes », et de vos réponses, riches et nombreuses, je vais tenter de vous mitonner des « Calicouffettes ».
Les ingrédients pour commencer.
— Je prends deux passages de Chandra :
« Mettre en évidence le statut différent des restes à une époque où tous les foyers, loin de là, ne disposaient pas de réfrigérateur. »
« Dès lors une autre problématique se fait jour : le statut des restes est très différent selon qu’il s’agit de restes domestiques qu’il est licite d’accommoder pour son usage personnel ou de restes de nourriture faisant l’objet d’un échange commercial. La ligne de partage entre ces deux statuts des restes se fait selon l’implication même potentielle de l’argent dans la mise en circulation de la nourriture en question. »
J’ajoute une touche de Jean-Pierre :
« Il me semble que l’enfant et les parents doivent avoir une idée approximative de ce qui sera mangé. L’assiette est donc remplie en fonction de cette évaluation approximative intuitive. On peut bien sûr des fois se tromper un peu, mais globalement l’idée générale est que l’assiette doit contenir ce qui sera mangé. Il y a là comme une pédagogie répétée de la différence entre désir et besoin. »
— Deux doses de Frédéric :
« On finit son assiette parce qu’on doit faire honneur à ceux qui l’ont préparé. »
« Les repas étaient (et sont toujours) intégrés dans une logique communautaire qui impose un équilibre entre désirs et goûts personnels, partage collectif et codes relationnels de respects mutuels. »
Aux ingrédients récupérés, j’ajoute un liant. Le liant de ma grand-mère, c’était souvent du gruyère râpé. Moi ce sera un souvenir.
J’étais prof de sciences économiques et sociales. En seconde, on faisait un cours sur la consommation. Consommation individuelle, consommation collective, avec un petit détour sur les consommations familiales. Ce que l’on consomme non pas seul, en individu, mais dans le groupe familial. Et comme exemple, je donnais les repas. L’heure du repas, la composition du repas, ce n’est pas chacun qui décide, mais le groupe familial.
Mais voilà qu’un jour, je sens une réticence dans la classe. Ce que je dis ne passe pas.
Bon OK, le repas de midi, c’est du collectif (self d’entreprise ou self scolaire), mais le matin et le soir, c’est bien familial ?
Dans les yeux des élèves, ça continue de dire NON. Le petit-déjeuner ? Rapide tour de classe. Vu les horaires des uns et des autres, le petit-déjeuner, c’est chacun derrière son bol en ordre dispersé.
Bon, mais le repas du soir ? Le repas du soir, c’est « en famille » ? Non ?
On a fait le compte. Ceux qui prenaient le repas du soir « en famille », c’était moins de la moitié de la classe. Chez les autres, c’était le frigo — celui de Chandra.
Un plat tout préparé, acheté tout préparé — encore Chandra et l’implication de l’argent, mais là l’argent s’est glissé dans le groupe familial.
Et alors si ce que je mange, c’est un plat préparé, la quantité du plat, c’est l’industriel qui l’a décidé — et donc exit « l’idée approximative de ce qui sera mangé » des parents de chez Jean-Pierre.
Et celui (celle) qui a « préparé le repas » est totalement invisible. Comment imaginer le travail de celui qui a préparé quand on fait réchauffer une barquette au micro-ondes ? Alors exit aussi « l’honneur » évoqué par Frédéric.
Et alors les restes que l’on jette, c’est le « trop » que l’industriel a mis pour satisfaire le plus grand nombre. Ça ne fait injure à aucun travail repéré [2]. C’est chacun à son tour — il n’y a plus d’horaire commun.
Ce que je décris pour le repas du soir « éclaté » à la maison est évidemment encore plus vrai au self de l’entreprise ou de l’école : quantité standardisée, invisibilité de celui qui a préparé. Choix individuel, même si je prends mon repas en commun car le self propose un choix.
Mes « Calicoufettes » sont prêtes. À vous de déguster. J’espère qu’il n’y aura pas de restes.