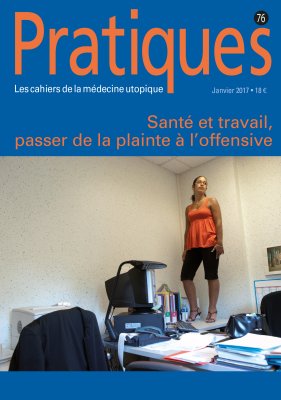Entretien avec Paul François
Agriculteur
-
-
-
- Comment, à partir d’une demande de reconnaissance en maladie professionnelle après une intoxication aiguë au Lasso®, on en vient à mener un combat contre Monsanto. Une longue épopée qui mène à accompagner ses pairs et à militer pour une autre forme d’agriculture.
-
-
Pratiques : Pouvez-vous nous raconter votre histoire ?
Paul François : J’ai 52 ans, je suis fils et petit-fils d’agriculteur. J’ai commencé à travailler à l’âge de 14 ans. En 1987, je me suis installé sur 30 hectares de céréales puis j’ai repris l’exploitation familiale. J’exerçais une culture très intensive basée sur la chimie. Cela m’apportait un confort économique, réduisait le travail physique et augmentait les rendements. À la fin des années quatre-vingt-dix, j’avais constaté que les rendements ne progressaient plus et que je commençais à avoir des problèmes dans les sols avec l’utilisation de la chimie. Je m’étais remis un peu en question à ce moment-là, mais jamais je n’aurais pu imaginer qu’il pouvait y avoir un problème pour la santé des utilisateurs et qu’il existait des manières de faire sans ces produits. En 2000, je me suis associé avec un voisin pour partager les charges de production. On travaillait 400 hectares avec deux salariés. Mon travail, c’était les semis et tout ce qui était la pulvérisation deux fois par an de trois traitements, herbicide, fongicide et insecticide. Par an, je traitais près de 2000 hectares de culture. Au cours de l’été 2004, je me suis occupé du nettoyage de la cuve de traitement. J’ai ouvert cette cuve restée en plein soleil pensant qu’elle était vide. L’herbicide qui était dedans, le Lasso®, était devenu gazeux. J’ai inhalé ces vapeurs, ça m’a chauffé tout le corps. Je suis rentré chez moi pour m’allonger et j’ai perdu connaissance. Ma femme m’a emmené aux urgences de l’hôpital local. Elle a pris la précaution de fournir l’étiquette du produit aux médecins qui m’ont reçu. Malgré cela, le centre antipoison de Bordeaux n’a pas contacté le fournisseur. Ils ont simplement conseillé de me garder en observation pendant 48 heures, sans demander aucun dosage dans le sang et les urines pour quantifier l’intoxication. Je suis rentré chez moi trois jours après, très fatigué et gêné pour respirer. Ayant signalé mon intoxication à la Mutualité sociale agricole (MSA) via le dispositif Phyt’attitude, un médecin de la MSA est venu me rendre visite. Il m’a dit que mes symptômes étaient normaux, que tout allait rentrer dans l’ordre et que j’allais pouvoir reprendre mon travail.
J’ai repris cinq semaines plus tard fatigué avec des maux de tête, des troubles de l’élocution. Le mois de juillet est très chargé. Je n’ai pas eu le temps de m’arrêter. En août, je suis retourné voir mon médecin car j’avais des absences à répétition, des problèmes de concentration, une irritabilité et une perte de poids. Le 29 novembre j’ai été réadmis aux urgences pour perte de connaissance. À partir de là, j’ai été hospitalisé dans divers hôpitaux pendant cinq mois car je tombais régulièrement dans le coma. Il a été constaté un dérèglement épileptique. On m’a fait prendre un traitement, mais les médecins ne parvenaient pas à l’équilibrer. J’ai finalement été transféré à Paris à la Salpêtrière. Les médecins ont fait de nombreuses investigations sans jamais prendre en compte l’intoxication. Ils évoquaient le surmenage et des troubles psychiques. C’est seulement en mars 2005 que le lien entre mes problèmes de santé et l’intoxication au Lasso® a été fait, et ce grâce aux recherches de mon entourage qui se demandait si mes problèmes n’étaient pas dus au produit.
Mon épouse avait pris contact avec André Picot, toxicologue et directeur de recherche au CNRS (centre national de la recherche scientifique). Celui-ci a dit que mes troubles étaient typiques d’une intoxication au monochlorobenzène, mais qu’il ne pouvait expliquer que les symptômes apparaissent six à douze mois après. Il a proposé de pratiquer des prélèvements d’urine et de sang pendant un des comas pour voir si l’on ne retrouvait pas le métabolite (élément issu du métabolisme) du produit. C’est ce qui a été fait sous la pression de mon épouse. En avril 2005, j’ai été réhospitalisé en psychiatrie avant d’avoir les résultats d’analyse de ces prélèvements. Je me disais que si j’étais dépressif, il fallait me soigner en conséquence. Dès le premier jour, le chef de service a dit que j’étais simplement anxieux parce que malade et non l’inverse. Le métabolite du produit a été retrouvé dans mon organisme, ce qui a confirmé que mes problèmes de santé n’étaient pas dus à des troubles psychiatriques. Concours de circonstance, André Picot avait auparavant été appelé comme spécialiste de la dioxine au chevet du président ukrainien Loutchenko empoisonné. À cette occasion, il a pris connaissance d’un traitement ayant un pouvoir chélateur sur les toxines, les éliminant par les voies naturelles. Contre avis médical, j’ai demandé à être transféré en Charente et à suivre ce protocole de traitement. En juin 2005, j’ai pu reprendre mon activité à temps partiel.
Mon intoxication avait été reconnue comme accident du travail par la MSA. J’ai alors fait une demande de reconnaissance en maladie professionnelle (MP). J’avais, en plus de ma couverture par la MSA, une assurance privée qui a permis l’embauche d’un salarié supplémentaire pour l’exploitation. Cette assurance avait établi que mon arrêt de travail était bien lié à l’intoxication et que c’était donc une maladie professionnelle, pourtant la MSA m’a refusé la prise en charge en MP. J’ai fait un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) avec un premier avocat. Certains experts constatant que c’était Monsanto qui avait fabriqué le produit préféraient ne pas intervenir dans le dossier. En 2006, André Picot m’a mis en relation avec Henri Pezerat qui avait travaillé sur l’amiante pour qu’il m’aide dans mon travail de preuves pour ma reconnaissance en MP. J’ai rencontré ce dernier à Paris et il m’a conseillé de changer d’avocat. C’est ainsi que j’ai rencontré François Lafforgue. Là, la procédure a pu avancer. En novembre 2008, le TASS d’Angoulême a reconnu que mon arrêt de neuf mois et mon état de santé étaient bien liés à cette intoxication. La MSA a fait appel de cette décision et c’est en janvier 2010 que la cour d’appel de Bordeaux a confirmé la décision que je devais être pris en MP suite à l’inhalation du Lasso®.
Pendant cette procédure, alors que j’étais hospitalisé, nous avions contacté Monsanto pour voir si le fabricant avait déjà eu des problèmes avec ce produit, ne serait-ce que dans les usines où ça se fabrique et s’il avait un antidote. Monsanto disait qu’il n’avait jamais eu de problème avec ce produit, qu’il ne fallait pas s’inquiéter. Il ne me donnait pas de renseignements, mais il me demandait mon dossier médical pour pouvoir comprendre…
J’avais découvert entre-temps que ce produit avait été interdit par le Canada dès 1985. J’ai également pu accéder en Belgique au dossier d’homologation du Lasso®, indiquant que ce produit était retiré du marché belge depuis 1991, car la firme refusait de répondre aux questions du ministère de l’Hygiène et de la Santé belge concernant les effets du produit sur la santé humaine. Monsanto ne pouvait donc pas ignorer la dangerosité et il aurait dû être plus explicite et préciser que, dans certains cas de figure, il fallait s’équiper de protections adaptées. Devant ce constat, j’ai proposé à mon avocat d’attaquer Monsanto. S’il était prêt à me défendre, il y avait plusieurs problèmes à une telle décision : ce n’était pas sûr que la justice prenne en compte cette plainte et l’accident ayant eu lieu en 2004 et le délai de prescription après un accident étant de trois ans, il fallait attaquer Monsanto avant avril 2007. Mon avocat m’a indiqué qu’il s’agissait d’une procédure qui durerait 10 à 15 ans, très coûteuse et très éprouvante. Le tribunal de grande instance (TGI) de Lyon (le siège social de Monsanto en France est à Lyon) a accepté la plainte. La procédure a débuté en février 2007. En novembre 2007, le produit était retiré du marché en France. En novembre 2011, le procès a eu lieu. Le TGI de Lyon a condamné Monsanto en février 2012 à me dédommager des conséquences de l’utilisation du Lasso® par faute d’information sur sa toxicité et ses conditions d’utilisation. Ils ont fait appel de cette décision le jour même. Cela a été rejugé en appel en mai 2015 et le jugement a été confirmé. Monsanto a fait un pourvoi en cassation et les plaidoiries auront lieu fin novembre 2016. Le délibéré devrait être pour début 2017. Monsanto n’a toujours pas versé un centime, parce que le montant des indemnités n’a pas encore été fixé par le tribunal, j’espère que ce sera fait avant 2018. Mais même si ce montant est cohérent avec les dommages subis, Monsanto pourra faire appel de cette décision et pourra même aller en cassation. J’ai dû avancer près de 38 000 € pour les frais annexes de cette procédure et n’ai pas encore réglé mes avocats. Si ma motivation avait été l’argent, j’aurais pu m’y prendre autrement puisque Monsanto aurait accepté de m’en verser. Je suis allé témoigner à La Haye au tribunal et j’ai pu constater qu’au niveau mondial, Monsanto a la même politique : leurs produits ne sont pas dangereux et ils sont plus forts que les gouvernements, voire les juges ! À chaque étude, ils mettent en place une machine à broyer les chercheurs et ce dans tous les pays qui ont pu témoigner. C’est un produit qui leur rapporte énormément d’argent, il faut continuer à l’utiliser et tant pis si ça tue des gens. L’élément nouveau est que Bayer est en train de racheter la société Monsanto. La question est maintenant de savoir quel comportement va avoir Bayer dans cette procédure.
Comment s’est créée l’association Phyto-Victimes ?
En 2010, j’ai été sollicité par les médias, des contacts se sont tissés avec d’autres agriculteurs, dont Dominique Marchal, le premier à avoir été reconnu en MP en 2006. « Générations futures » a pris l’initiative d’une rencontre sur la toxicité des pesticides sur la commune de Ruffec en Charente. En tant que professionnels, nous nous sommes aperçus que les syndicats avaient beaucoup de peine à s’emparer de ce sujet et il nous est apparu évident qu’il fallait peut-être réfléchir à nous fédérer avec d’autres agriculteurs. C’est comme ça qu’en mars 2011, on a créé l’association Phyto-Victimes. Phyto, comme phytosanitaire, parce qu’entre agriculteurs, on ne parle pas de pesticides ou parle de « phyto ». Très vite l’association a grandi, la région Poitou-Charentes nous a donné des fonds et nous avons pu employer des salariés. Nous colligeons toutes les études et enquêtes qui démontrent la toxicité des pesticides. Une salariée s’occupe essentiellement des victimes (+ de 250 à ce jour) et une autre s’occupe de tout ce qui est relationnel et événementiel. Nous avons embauché une troisième personne parce que nous sommes débordés par les appels et les demandes.
Le jour où vous avez porté plainte, vous attendiez-vous à vous retrouver porte-étendard de ce combat ?
C’est vrai que j’en suis devenu un bien malgré moi puisque je suis le premier à avoir fait condamner Monsanto dans le monde. Je n’aime pas les mots héros et courageux, je suis surtout tenace et déterminé. J’ai eu la chance de rencontrer des gens formidables qui m’ont aidé. On ne peut pas se battre tout seul contre Monsanto. J’ai essayé de faire le lien entre tout ce que je pouvais connaître ou entendre et voir ce que l’on pouvait faire. Si je devais recommencer, je ne le referais pas, c’est trop violent. La stratégie de harcèlement et la pression des avocats de Monsanto est très dure. J’ai failli arrêter le procès entre la 1re décision et la cour d’appel en novembre 2014, j’étais épuisé. Mon entourage m’a soutenu : « Tu ne peux plus arrêter parce qu’il y a trop de gens qui comptent sur toi et si tu arrêtes, c’est protéger Monsanto ! »
Quelle est aujourd’hui votre position vis-à-vis du bio ?
Dès 2004, on a travaillé différemment sur l’exploitation, on a cherché à diminuer le plus possible l’utilisation des phytos. Certains me disaient : « Vous ne faites pas du bio ». Le bio c’est difficile, c’est un autre métier. Mes deux filles m’ont gentiment dit : « Papa, tu devrais t’intéresser au bio ». Je suis allé visiter des exploitations semblables à la mienne et j’ai rencontré des agriculteurs qui avaient dix ans de bio, qui étaient bien dans leur métier et en vivaient correctement. En plus, je ne voulais plus utiliser de produits dans la zone très urbanisée où j’exerce, il y a des habitations et des zones commerciales autour. De fil en aiguille, on a décidé de passer en version bio une partie de l’exploitation, on sera reconnu en agriculture biologique à partir du 1er mai 2017. Pour l’instant, ça se passe très bien, nous avons le projet de mettre en bio les parcelles qui ne le sont pas encore à partir de 2018. Quand j’arrêterai, j’espère laisser une exploitation propre et totalement bio. Sur de la production céréalière, on est capable de répondre à la demande avec des produits de qualité. Mais ce changement n’appartient pas qu’au monde agricole, c’est aussi le consommateur de demain qui prendra cette décision d’une autre agriculture. Les agriculteurs, depuis dix ans, commencent à se poser des questions, ils constatent où les a menés l’agriculture intensive. Du point de vue économique, on leur avait promis monts et merveilles et maintenant, ils ne parviennent plus à gagner leur vie. Ils connaissent des collègues malades. Il ne se passe pas une journée sans qu’on parle des pesticides. La plainte contre les viticulteurs ayant pratiqué des pulvérisations près de l’école de Villeneuve-de-Blaye a abouti à une mise en examen de deux châteaux. Nous interpellons nos collègues : on ne peut plus traiter à côté des écoles, on ne peut pas traiter le long des riverains en faisant tout et n’importe quoi. Certains agriculteurs sont dans le déni. Les agriculteurs doivent être force de proposition avec des mesures de bon sens pour que la cohabitation entre les producteurs et les riverains se passe bien. Le vrai problème est que certains auront une double peine, ils seront malades et sur le banc des accusés en même temps.
Votre association apporte-t-elle un soutien aux producteurs qui veulent changer ?
Nous sommes très prudents. Notre but est d’abord d’aider les victimes. Maintenant, quand des agriculteurs nous demandent comment ils pourraient faire autrement, nous les mettons en relation avec les réseaux que nous connaissons. Les victimes subissent une pression vis-à-vis de leur demande de reconnaissance en MP parce qu’ils continuent d’utiliser les pesticides et, du coup, ils hésitent. Nous les rassurons en leur disant que de ne pas demander cette reconnaissance en MP, c’est faire le jeu des firmes. L’argent ne les guérit pas, mais ça les aide matériellement car les situations sont difficiles quand vous êtes absents de votre exploitation. D’ailleurs, l’association a un projet de loi pour créer un fonds d’indemnisation abondé par les firmes pour les victimes et porté par la sénatrice de la Charente Nicole Bonnefoy. On va bien voir quels comportements vont avoir les syndicats agricoles, en particulier la FNSEA, et des élus pour le faire.
De plus, en reprochant aux agriculteurs de ne pas faire du bio, on les culpabilise et les entreprises disent que les agriculteurs n’ont pas fait attention, et que c’est pour cela qu’ils sont malades. Les agriculteurs n’ont fait que suivre les précautions qu’on avait il y a vingt ou trente, voire cinquante ans. Tant qu’on ne parviendra pas à faire augmenter les reconnaissances en MP, les firmes continueront de dire « Vous voyez bien que les produits ne sont pas dangereux ». Si on regarde ce qui s’est passé avec l’amiante, il a fallu qu’il y ait les reconnaissances en MP pour montrer que l’amiante était dangereuse et pour l’interdire, en cela l’expérience d’Henri Pezerat nous a beaucoup servis. Elle nous permet d’insister sur le fait qu’il faut faire une autre agriculture parce que si c’est dangereux pour nous, ça l’est aussi pour les consommateurs. Nous avons travaillé avec des sociologues, il faut sept à huit ans à un agriculteur entre le moment où il se pose la question et sa conversion. Si ces agriculteurs ont utilisé ces pesticides, c’est parce que notre société a produit des consommateurs qui veulent toujours moins cher et plus abondant, ce n’est pas compatible avec une agriculture bio. On ne fait pas ce métier tout à fait par hasard, il faut être passionné, c’est une vocation et la plupart d’entre nous ont cette vocation. Nous avons cru en un système de production dans lequel nous avons trouvé des avantages au départ, avec l’impression de bien faire notre métier et de répondre aux demandes de nourrir la planète. C’est exigeant et valorisant. Quand on découvre que ce système d’une part nous a empoisonnés et qu’en plus on a peut-être empoisonné nos enfants, nos voisins et les consommateurs, le constat est très dur. Ce système est une fuite en avant il ne profite qu’aux firmes au détriment de la santé des populations.