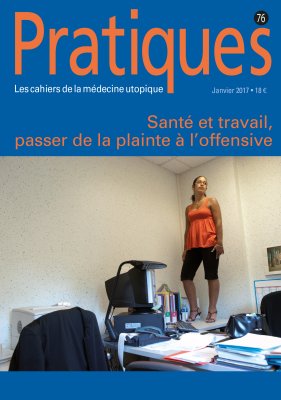Entretien avec Charles Piaget
-
-
-
- La longue lutte des LIP a montré la capacité des collectifs ouvriers à prendre la parole, à penser le travail et les conditions de son exercice.
-
-
- Pratiques : Pouvez-vous vous présenter ?
Charles Piaget : J’ai 88 ans, mon père venait de Suisse, il s’est installé à Besançon comme horloger « à domicile », il réparait les montres. Je n’ai pas connu ma mère, cela reste un mystère. Mon père est mort quand j’avais 15 ans. J’étudiais alors la mécanique en lycée technique. J’ai été recueilli par une famille formidable d’immigrés italiens qui avait trois enfants. Il fallait que je me dépêche de travailler pour contribuer aux dépenses familiales. J’ai obtenu mon CAP et puis un brevet. À LIP, ils embauchaient. Nous étions une dizaine de jeunes. Le chef du personnel nous a expliqué que notre habileté pratique était insuffisante. Durant une année, nous nous sommes perfectionnés dans un atelier-école sans participer à la production. C’était les lendemains de la guerre, il y avait une atmosphère exceptionnelle, nous avions des heures consacrées au sport, nous sommes même partis une semaine en montagne payée par l’entreprise. Le chef du personnel était quelqu’un de très affable, il existait une réelle écoute. Aussi, quand on me parlait de syndicalisme, je n’en voyais pas l’utilité…
En 1948, je suis parti au service militaire. Quand je suis revenu en 1949, tout avait changé, le chef du personnel n’était plus le même et on nous a signifié qu’on ne nous reprendrait pas, ça a été un choc. Nous avons été étonnés d’apprendre que le service militaire représentait une rupture du contrat de travail de notre responsabilité ! Un de nous a répondu : « Vous avez dépensé de l’argent à former des personnes et vous dites tant pis pour tout ça, on ne vous reprend pas ? ». Deux jours après, je recevais une invitation à revenir à l’usine, on était tous réembauchés. Nous avons été intégrés dans l’atelier le plus haut de gamme de la mécanique. C’était difficile, d’autant qu’à l’époque le travail était encore très manuel. Là il y a eu un deuxième choc : refus total des anciens de nous donner le moindre conseil. On a compris rapidement qu’ils avaient réussi à arracher un salaire élevé parce qu’il n’y avait plus guère de mécaniciens de ce niveau après la guerre. Ils nous voyaient donc comme de futurs concurrents. Nous avons discuté dans notre petit groupe : « Puisque personne ne veut nous montrer, pourquoi on ne prendrait pas chacun un carnet où on écrirait tout ce qu’on fait : nos découvertes, nos échecs et leurs raisons. » On s’est repassé les carnets et un jeune a conclu « puisqu’on est dix, on devrait aller dix fois plus vite ». Il venait de découvrir la force du collectif sans le savoir. On a beaucoup travaillé ensemble, on a inventé des solutions pour compenser l’absence de « coup de main » et on a réussi beaucoup plus vite qu’on ne le croyait à rejoindre les champions de l’atelier.
Troisième choc. Après la guerre, on travaillait 52 heures par semaine et jusqu’à 56 heures parce qu’on nous demandait fréquemment de venir le samedi après-midi. Il y avait encore les rationnements, on avait souvent faim, il n’était pas facile de « joindre les deux bouts ». Un jour, le responsable de la mécanique nous rassemble et nous explique que l’entreprise traverse une nouvelle zone de turbulence économique et que les heures supplémentaires allaient être supprimées, sauf si nous acceptions de les faire sans majoration. Pour nous, 12 à 16 heures supplémentaires, c’était un gros morceau de notre salaire. Je me suis rendu compte à quel point j’étais loin du syndicalisme, parce que j’avais tellement besoin de cet argent que j’étais prêt à accepter. Heureusement, certains se sont élevés en expliquant tout ce que représentaient les heures supplémentaires, la loi etc. Le directeur est reparti sans rien, on est restés environ trois semaines sans heures supplémentaires. Puis ils les ont rétablies avec les paiements normaux. Une année plus tard, le même directeur nous annonce la suppression d’une prime de production. Nous avions un salaire de base très faible et une succession de primes dont on ne comprenait pas à quoi elles correspondaient, mais c’était important. Nous nous sommes consultés et nous avons décidé de faire grève, de déposer les outils et de rester sur place. On ne savait même pas qu’il était interdit de faire grève sur le tas. On est restés là en disant qu’on ne reprendrait pas le travail dans ces conditions. Ça a duré deux jours et le directeur a demandé à deux personnes de venir pour discuter. Les autres m’ont poussé et j’y suis allé avec un copain. Le directeur a rétabli la prime. On a appris plus tard que ce n’était pas notre grève qui avait joué, ils avaient reçu une grosse commande et ils étaient pressés qu’on reprenne le travail. Puis il y a eu des élections de délégués du personnel. Entre-temps, je m’étais marié, le secrétaire de la CFTC est venu me trouver parce qu’il avait appris que j’avais « négocié » cette prime suite à notre grève. Je ne voulais pas du tout être délégué. Il est parvenu à me convaincre de m’inscrire en fin de liste pour que je ne sois pas élu, afin d’apporter des voix à la CFTC. Ce que j’ignorais, c’est que les électeurs pouvaient rayer des noms sur la liste. C’est ainsi que j’ai été élu délégué du personnel contre mon gré… Une fois élu, il fallait que j’y regarde de plus près. Désormais, j’avais le droit de circuler dans l’usine, ce qui était interdit par le règlement intérieur. Toute personne qui se trouvait ailleurs qu’à son poste était licenciée. Personne ne connaissait l’usine dans son ensemble. J’ai donc eu, sous certaines conditions, la possibilité de visiter l’entreprise et cela m’a ouvert les yeux. Je me suis rendu compte que j’étais un privilégié ! Dans notre atelier, on avait la possibilité de s’asseoir, on avait des tabourets, on pouvait se parler, on échangeait pour obtenir une machine, on pouvait circuler alors qu’ailleurs ce n’était pas du tout ça. Dans les ateliers de production travaillaient les ouvriers spécialisés à qui on montrait en une heure ce qu’il fallait faire et ils se mettaient au travail. Debout ou assis devant une machine automatique, ils chargeaient les pièces. C’était essentiellement des femmes. Un bruit infernal, les machines serrées les unes contre les autres, il y avait des projections d’huile de partout. Le premier atelier où je suis entré, les femmes n’avaient pas le droit d’être assises. Ensuite je suis allé à l’horlogerie, je n’arrivais pas à croire que c’étaient des professionnels hautement qualifiés, ils étaient une trentaine, tous en ligne sur leurs petits établis, courbés dans un silence total. Il y avait une estrade derrière avec le chef qui dominait tout et surveillait ces gens dans le dos. J’y allais pour un problème de prime. Quand je me suis adressé au chef pour lui demander des explications, il ne m’écoutait pas du tout. Il avait le regard fixe, je me suis demandé s’il n’était pas malade… Tout à coup, il s’est levé et s’est mis à faire le tour de son atelier à grandes enjambées, il est revenu et m’a enfin regardé en me disant : « Il m’a semblé entendre un murmure ». Un autre événement m’a appris ce qu’était le patronat. La loi oblige la direction à recevoir mensuellement les délégués du personnel pour écouter les problèmes rencontrés par les salariés et leurs revendications éventuelles. Ce devait être lors de la troisième réunion, on commençait la discussion, tout à coup le patron en colère surgit sans frapper et se met à insulter en hurlant une déléguée CGT, l’horreur. On est restés pétrifiés. Pas un n’a bougé et quand il a eu vidé son sac, il est parti. La réunion a été annulée, on avait tous honte. On a donc décidé de se réunir parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Nous étions ridiculisés dans les réunions parce que nous manquions de connaissances sérieuses sur la vie dans les ateliers. Soit on rendait notre tablier parce qu’on ne pouvait rien faire, soit on changeait profondément les choses. On est donc allés au syndicat pour commencer à nous former. On a repris l’idée des carnets, pour que chaque délégué puisse prendre des notes sur les lieux où les salariés se rencontrent et se parlent. Dans ces lieux de rassemblement, ça discute de ce qu’ils ont fait la veille, mais ils parlent aussi du travail. On a décidé entre nous qu’un véritable militant syndical, ce n’était pas un champion dans l’étude des dossiers, dans la discussion ou la négociation. Ce qui était le plus important, c’était de préparer et de former des collectifs dans les différents ateliers et bureaux. C’était de regrouper les gens, de les écouter, de leur donner de l’information, de constituer un réseau vivant. Tout ça, ça a constitué la pierre de touche de notre réussite par la suite.
- Là, on en vient à la grande lutte des LIP.
Cette lutte a été tellement spectaculaire et a eu une telle notoriété que les militants, les ouvriers, tous les gens en général marquaient leur étonnement. On nous demandait : comment faites-vous pour arriver à mettre dans le coup autant de gens ? À mobiliser et à faire participer à la lutte presque la totalité des salariés, à avoir autant d’idées ? Comment avez-vous réussi à faire l’unité syndicale ? Et là on leur expliquait notre cheminement collectif. Chaque conflit, chaque petit problème a été l’occasion de renforcer notre capacité à mobiliser.
En 1968, au moment du lancement de la grève générale, les délégués s’étaient réunis pendant le week-end pour préparer l’appel à la grève qui devait être lancé le lundi. Quand on est arrivés à 6 h 30 devant l’usine, il y avait des militants de l’union locale avec des manches de pioche qui empêchaient les ouvriers de passer. On les a tout de suite apostrophés en disant que nous allions d’abord consulter les gens pour savoir s’ils souhaitaient ou non rejoindre la grève. On est donc entrés dans l’usine après avoir distribué un tract invitant les gens à venir débattre au restaurant pour prendre la décision. Ils sont partis et nous ont laissés nous organiser à notre façon. À l’intérieur, deuxième assaut : le patron était là avec une vingtaine de cadres pour nous proposer de négocier immédiatement. On a dit non, pas question de négocier en ce moment, nous voulons d’abord consulter les salariés. Si la grève générale est décidée, nous viendrons vous voir pour la négociation. C’était très habile de leur part pour désorganiser la consultation en mettant tout de suite les délégués à part et en leur faisant des propositions.
En 1970, le patron s’est rendu compte qu’il avait mal mesuré notre force. Il a monté une attaque contre nous par une restructuration bidon du secteur de la mécanique qu’il a déposée à la direction du travail. Il projetait de faire supprimer deux des ateliers où il y avait les personnes les plus dynamiques. Aussitôt s’est engagée une lutte de plusieurs mois sans grève, ce qui était nouveau. Nous avons appliqué une idée originale, tous les bâtiments affichaient leur solidarité avec des affiches collées sur les fenêtres qui dénonçaient le mauvais coup. Cela a été très fort, ils ont essayé de déménager des machines, il y a eu aussitôt un rassemblement pour empêcher le déménagement. Ensuite, on a organisé une surveillance la nuit pour ne pas qu’ils viennent refaire des coups de ce genre-là. Une désobéissance généralisée s’est installée dans toute l’usine. Les salariés ne fournissaient plus aucune information concernant le travail. Devant une telle paralysie, la multinationale a viré le patron historique pour installer un homme à eux comme PDG. Ils ont abandonné l’idée de la restructuration, mais ils préparaient déjà le fameux coup de 1973. Tous ces conflits antérieurs nous avaient aguerris. On était donc bien préparés d’un point de vue collectif.
Donc, en 1973, le patron historique de LIP avait vendu une bonne part de ses actions à une multinationale suisse, Ebauche SA, qui avait pris le pouvoir. Cette multinationale n’avait pas du tout les mêmes idées que l’ancien patron. Ce qu’elle voyait dans LIP, c’était tout simplement la marque et le fait d’être dans le marché commun. La mécanique, le montage, les fabrications, ça ne les intéressait pas du tout. Il y a eu l’annonce d’un plan terrible puisqu’ils fermaient toute une série d’activités et licenciaient au moins la moitié des salariés. On s’est rassemblés et on a décidé de lutter. Le conflit a duré une année, avec une multitude d’initiatives. Le collectif, ce n’est pas une simple addition, ni la répétition de la hiérarchie classique : ceux qui savent et ceux qui écoutent. Le collectif, au début, c’est pénible, c’est pas très « payant », mais progressivement, ça prend de l’ampleur et ça devient de plus en plus riche au fil des jours, des mois et des années et tout le monde est bénéficiaire. Là, on a tout de suite proposé de constituer des groupes de réflexion autonomes ce qui a affolé les organisations syndicales… En fait, la règle c’était de dire : « Tous ceux qui entrent dans la lutte sont égaux, ce conflit appartient à chacun (e) et il y a nécessité de réfléchir ». La réflexion, n’est pas l’apanage des délégués, ni du syndicat. C’est l’apanage de tout le monde, tout le monde est intellectuel à partir du moment où il se met à réfléchir. On a décidé d’occuper l’entreprise et là, on nous a coupé les salaires. On a décidé de relancer le montage des montres et de les vendre. Ça a été un coup de tonnerre dans le pays ! Il y avait constamment 80 à 100 LIP sur les routes pour expliquer et populariser la lutte, tenir des meetings, vendre des montres… Des délégations de vingt-cinq pays d’Europe et de nombreux autres pays, des cheminots japonais entre autres, sont venus pour voir comment on luttait. Une immense solidarité s’est créée autour de LIP, elle a été le fer de lance de notre réussite. Il y a eu une grande manifestation de soutien qui a rassemblé 30 000 personnes selon la police, nous, on pensait autour de 80 à 100 000. C’était extraordinaire. On a réussi à payer 800 personnes pendant sept mois, ça représente quelque chose ! Après quatre mois d’occupation, le gouvernement s’est décidé à faire évacuer l’usine par la force et a fait occuper l’usine pendant six mois pour nous empêcher de travailler. Ils pensaient venir à bout de notre détermination, mais nous avions anticipé le coup de force. On avait caché hors de l’usine un stock important de pièces détachées, beaucoup de montres terminées, des établis, des machines… Après l’évacuation, on a monté des ateliers clandestins et on a continué de fabriquer des montres à Besançon. On avait un slogan : « L’usine est là où sont les travailleurs » en rappelant que l’usine ce n’est pas que des murs, des machines, c’est d’abord des êtres humains.
Il existait une vingtaine de commissions, on a eu environ deux cents Assemblées générales au cours de ce conflit. Mais l’Assemblée générale, ce n’est pas vraiment la démocratie, c’est le rassemblement pour expliquer ce qui s’est passé la veille, pour faire des propositions pour l’avenir, mais ça n’approfondit pas, il y a peu de personnes qui parlent en Assemblée générale. C’est pourquoi on a poussé à ce que les commissions prennent une partie du conflit en charge. Il y avait toutes les commissions possibles et imaginables de la production, de l’accueil, en passant par le restaurant, l’entretien de l’entreprise, les déplacements etc. qui réunissaient une vingtaine de personnes chacune. Là, beaucoup plus de personnes s’exprimaient, donnaient leur avis. Au début, nous délégués, nous avons choisi un local où on pouvait nous voir, les portes et les fenêtres étaient toutes ouvertes. Tous les matins, il y avait la discussion entre les délégués CFDT et CGT. Cela a consisté en un apprentissage du débat : quand quelqu’un soulève une idée, on ne répond pas en s’adressant à lui d’une manière agressive : « Je ne suis pas d’accord avec ce que tu viens de dire », non, on dit : « Moi je vois les choses autrement… », on explique mais on ne s’agresse pas, il faut arriver à faire comprendre que seul le respect, l’écoute permettent de progresser dans un collectif. Par exemple : « Les tourneurs, vous allez l’air de bien vous entendre, pourquoi vous ne vous mettez pas en groupe de réflexion ? » Un comité d’action s’est mis en route très vite. Quand les délégués se réunissaient, il y avait une trentaine de LIP qui entraient dans la salle, restaient un moment, ressortaient. Le comité d’action a très vite réuni une centaine de LIP pour discuter, réfléchir, ils avaient acquis une popularité plus rapidement que nous parce qu’ils s’exprimaient plus simplement. Beaucoup s’y sont impliqués, à tel point qu’il était impossible de tout contrôler. Ça a été le gros problème des syndicats. On avait défini en AG les valeurs sur lesquelles on se battait et les pièges à éviter : respectez partout ces valeurs-là et allez-y, faites des propositions d’actions, vous n’avez pas besoin d’avoir sans arrêt à demander au syndicat. Voilà comment ça c’est déroulé et on a fini par gagner. L’entreprise a redémarré. Tous les salariés en lutte ont été réembauchés.
Au bout de deux années de fonctionnement, la crise de 1975 est arrivée avec les « libéraux ». Les premiers symptômes de ce nouveau libéralisme économique sont apparus à cette période-là, même si le gouvernement ne l’a ouvertement mis en place qu’en 1979. Les pouvoirs publics, le patronat, constatant qu’il y avait des centaines d’entreprise qui fermaient, dont certaines étaient occupées, ont compris qu’il était très important que LIP ne se termine pas par une victoire. Sinon beaucoup de « LIP » allaient surgir en France. Sur ordre du pouvoir, les patrons de la nouvelle société se sont retirés et ont déposé le bilan, tous les LIP ont de nouveau été licenciés. Un nouveau combat s’est engagé et a duré quatre ans. C’était très difficile, car il n’y avait pas de création d’emplois et le chômage progressait. Nous avons créé légalement sept coopératives, mais on n’a pas pu embaucher tout le monde malgré nos efforts. On a été obligés de négocier un plan social pour les personnes qui n’arrivaient pas à se placer dans les coopératives, ils ont eu droit à des indemnités de chômage. Aujourd’hui, après 40 ans, il ne reste que deux coopératives. Les autres ont sombré au bout de 8 à 15 ans.
- Qui était ce patron historique dont vous parlez ?
Fred Lip était dans la résistance et est rentré dans son usine fin 1944 quand Besançon a été libéré. Il a été PDG de LIP jusqu’en 1971. C’était une petite entreprise familiale depuis 1867 qui est devenue grande. Il a été confronté aux difficultés de la concurrence, d’abord américaine avec des montres bien meilleur marché, mais de moindre qualité, puis japonaise avec des montres de qualité. Il a relancé l’activité en inventant une montre électrique et des chaînes de montage très efficaces. Quand les ventes se sont mises à plafonner, il s’est senti coincé. En 1967, il s’est associé à la multinationale pour avoir des échanges et une diversification des produits. Il avait fait signer un papier comme quoi Ebauche SA ne démolirait pas la manufacture avant cinq ans. En 1972, ils ont donc été libérés de leur engagement et ont déposé le bilan début 1973. On a découvert ces papiers après. La concurrence a amené le patron à chercher un appui, et cet « appui » est devenu le maître.
- Cela correspond à l’arrivée de la politique libérale…
Lors de la révolution de 1789, les marchands ont voulu se libérer de l’oppression féodale du roi. Il y a eu un accroissement de cette évolution dans le monde qui a installé le libéralisme à la fin du XIXe siècle. Après la crise de 1929, on ne pouvait plus laisser faire n’importe quoi. Roosevelt avec les idées de Keynes a réussi à imposer à sa classe de riches, des impôts pour relancer la machine. Cette économie libérale avait créé beaucoup de pauvres. J’ai été très étonné d’apprendre que les impôts des entreprises étaient encore à 70 % quand Reagan a pris le pouvoir en 1980. Même l’Europe n’est pas montée aussi haut pour redresser la situation. Les capitalistes avaient accepté une économie contrôlée au lendemain de la guerre, après 1929 et par peur du communisme. Il fallait contrôler les peuples de crainte qu’ils ne se révoltent. Mais à partir des années 1985, ils ont compris qu’ils pouvaient y aller. Ils n’avaient plus la peur de 1929 ni la peur du communisme. Maintenant, on va de crise en crise avec des inégalités fantastiques. On retrouve tous les problèmes qu’il y avait à l’époque, mais décuplés par la mondialisation. Les systèmes féodaux des grandes entreprises, de vrais monstres pleins d’argent, ont une puissance phénoménale.
Aujourd’hui, il faut reconquérir le fait que l’intérêt général doit passer devant les intérêts privés et dans le même temps réduire les inégalités. On a devant nous une longue période de croissance très faible qui ne permettra pas de résoudre le problème de l’emploi sans réduction du temps de travail. Il n’est plus possible de tabler que sur la croissance. Le ministère des Impôts a récupéré 28 milliards qui avaient été soustraits au fisc. Les entreprises moyennes et quelques riches ont fini par payer. Il faudrait accentuer cela et récupérer au moins 70 milliards. On doit aussi travailler sur ce qu’on doit fabriquer, privilégier les biens indispensables pour tous les êtres humains. Investir dans le logement par exemple et ce qui est nécessaire à l’intérêt général.
Le capitalisme a disséqué le travail à un degré complètement fou. On arrivait à avoir des gestes toutes les deux secondes, ce qui fait 14 000 gestes par jour. Le salarié qui a effectué 14 000 fois le même geste dans la journée n’est plus en capacité de réfléchir, de voir plus loin. Deux ouvriers de Kelton Besançon sont allés visiter l’usine Kelton en Alabama. Ils ont vu des jeunes filles noires capables de « charger » à 1,8 secondes. C’est de la folie, comment un être humain peut-il être traité de cette façon ? À partir du moment où on dit à quelqu’un : « Je te paye pour que tu fasses ça, le reste ne te regarde pas », on « l’ampute » d’une partie de sa réflexion.
Aujourd’hui, ce qu’il faut, c’est changer un certain nombre de règles de la société, organiser des groupes qui luttent contre les nuisances. Il faudrait qu’il y ait des collectifs partout qui se coalisent pour essayer de changer cette société. Il n’y a qu’à la base qu’on pourra construire cette puissance qui permettra de changer l’économie. Il faut construire des collectifs, repartir de la base pour arriver à faire un nouveau système, un nouveau pays, une nouvelle économie… Là je rêve…
Propos recueillis par Sylvie Cognard et Anne Perraut Soliveres